Des cadavres dans le placard.
Quand déménager fait « pschyyyyt » : les confessions d’Alice.
Quand déménager fait « pschyyyyt » : les confessions d’Alice.
La scène d’ouverture est calme, trop calme. La jeune Lili, juchée sur son vélo, traverse un pont vide où gît une voiture abandonnée, portière ouverte. Personne à l’horizon. Plus loin, ce sont les rues qui sont désertes, comme si malgré le jour et la lumière éclatante qui éclaboussent la chaussée, c’était la fin du monde pure et simple qui s’y était implacablement installée. Le silence règne quand soudain, surgissent aux trousses de l’enfant une meute de chiens enragés, galopant à en perdre haleine vers une destination que l’on ignore. Le spectateur entre alors dans « White God » avec un avant-goût d’apocalypse inexpliquée : les chiens fuient-ils ou poursuivent-ils la fillette ? Ont-ils un but ? Pourquoi continue-t-elle à pédaler, droit devant elle ? La séquence s’interrompt brutalement, et laisse en suspens l’issue de la scène, un plan large où la meute semble engloutir le vélo avant de disparaître derrière un mur, au ralenti.
Nous sommes à Budapest, en Hongrie. Pour favoriser la reproduction des chiens de race, le gouvernement impose une taxe sur les bâtards à tous les foyers. La jeune Lili et son chien Hagen se retrouvent alors entraînés dans un cauchemar sans fin où, séparés, ils doivent subir une loi implacable et arbitraire. La taxe devient ici une arme de dissuasion et de contrôle : vidée de son rôle de redistribution et de justice sociale, elle n’est plus qu’un châtiment cruel et sadique, dont l’oppression vicieuse dépasse de loin la pure et simple interdiction. Kornél Mundruczó utilise ici la parabole canine pour illustrer avec un réalisme troublant la société hongroise, où le gouvernement libéral et nationaliste de Viktor Orbán cohabite dans les sondages avec le parti d’extrême-droite Jobbik.
Wild dogs
Jeté à la rue par le père de Lili, qui craint la nouvelle taxe, Hagen quitte le cocon domestique et tente de survivre à l’état sauvage, avant de rejoindre un groupe de chiens errants. L’instabilité et les sursauts permanents de la caméra illustrent ici le sentiment d’urgence et de fébrilité qui anime Hagen, égaré mais traqué. La jeune Lili, elle, garde tout au long du film ce visage grave et mature, incrustant au milieu d’un casting presque uniquement masculin l’empreinte d’une force féminine de résistance sans âge, sans illusion. Les seules marques de douceur qu’elle manifeste sont l’affection qui la lie à son chien et à sa musique. Comme un triangle fragile, Lili aime Hagen, puis joue de la trompette. Hagen écoute et s’endort en aimant Lili. Cet équilibre, qui pour certains frôlera la mollesse voire l’idéalisme mielleux, révèle pourtant l’issue du film. Cette vingtaine de minutes, où le réalisateur nous plonge dans l’insurrection de plus de deux cent chiens « échaudés » par leur séjour en fourrière, monte crescendo pour exploser en attaques sanglantes voire carrément gores des anciens maîtres de la cité. Le plan final lui, semble être le constat froid que la servitude volontaire reste l’indépassable condition du système.
On connaît déjà toute la cruauté que les hommes savent infliger aux animaux, et surtout à ceux qu’ils prétendent domestiquer. Et celle qu’a voulu nous montrer Kornél Mundruczó, la pire peut-être, est ce transfert, cet apprentissage brutal du désir de tuer et d’éliminer. C’est l’invention de cette haine qu’infligent à Hagen les hommes du film, des courses-poursuites épuisantes pour échapper à la fourrière aux combats de chiens organisés sous les toits de tôle, la mort en jeu. Lorsqu’il est vendu par le propriétaire d’un restaurant à un dresseur particulièrement véreux et organisé, Hagen entre dans ce cercle vicieux. Celui où le dominant orchestre, par les coups et les drogues, le glissement rampant de l’esprit simple et confiant du dominé vers la soif sanglante de détruire. La mise en scène de la violence humaine, qui rappelle à certains égards celle du film « Amours chiennes », d’Alejandro González, tient tant dans l’oppression chronique des lois naturelles que politiques. Les hommes, en plus d’avoir le pouvoir de cette « violence légitime » sur l’animal, peuvent aussi légiférer et choisir de laisser vivre ou de faire mourir. Un constat cynique et cinglant des dérives de l’autoritarisme et de la manipulation des masses, qui résistent ou renaissent encore aujourd’hui en Europe.
WHITE GOD, de Kornél Mundruczó
Avec Zsófia Psotta, Sándor Zsótér, Lili Horváth
Hongrie, 2014, 1h59
Flickr Aurele Beeden Gala
Dans un roman vif et acéré, Gauz nous plonge dans l’histoire et le quotidien de ces immigrés africains reconvertis en vigiles des magasins parisiens. Un récit rapide, mais efficace, qui n’épargne personne, où l’auteur raconte un Paris d’hier et d’aujourd’hui, avec ses lieux communs, ses magasins, ses pièges et ses immigrés.
L’histoire commence comme celle de beaucoup d’entre nous : dans une queue, attendre pour un emploi, remplir et montrer des papiers, trouver une place, au milieu de tous les autres. Cette place, c’est celle du vigile, « debout-payé ». Un job facile, un sésame pour beaucoup d’immigrés africains, ces funambules aux multiples styles, langues ou histoires. Comme l’écrit l’auteur Gauz, Armand Patrick Gbaka Brédé de son vrai nom, Ivoirien d’origine, « Quand on sort du chômage, on manque d’assurance ». Une ironie qui lance le ton du livre, sans condescendance. Né à Abidjan et arrivé en France à 28 ans, l’auteur a connu « les arcanes de l’administration », celle qui rend fous les Français de souche et se fout royalement de ceux d’en dessous, les sans-papiers. Gauz a écumé tous les petits boulots : scénariste, baby-sitter, jardinier, réalisateur, hotliner, vigile. Il raconte et se raconte aussi dans ce roman, qui plonge le lecteur dans la peau de ces hommes omniprésents, mais invisibles, les agents de sécurité.
De Camaïeu à Séphora, Gauz décrit ces jungles familières et climatisées, bondées de monde où règnent l’opulence et les fastes de l’hyperconsommation. Ces lieux que nous croyons connaître, voire même parfois exécrer sans les comprendre. L’auteur, à travers ses lunettes de vigile, scinde, tranche et sonde avec pertinence nos propres comportements. Et tout le monde y passe, comme au scanner : les filles, grosses ou maigres, les voleurs, les Africaines et les Chinoises, leurs fesses et leurs maris, les bébés, les prix, les vieux, les cheveux ou les handicapés. En somme, dans un décor en carton-pâte qui clignote et où « Tout est en soldes, y compris l’amour-propre », il éclaire aussi ce qui anime encore notre société, bricolée de toutes ces petites fausses notes.
« Quand on ne comprend pas l’autre, on l’invente »
Des flashs lucides, mais qui ne prétendent pas à la science encyclopédique : comme il est remarqué dans le livre « Quand on ne comprend pas l’autre, on l’invente, souvent avec des clichés ». Ces petites chroniques des grands magasins laissent aussi place à l’imagination de l’auteur, comme lorsqu’il imagine des « nommeurs », dont le métier consiste à inventer autour d’une table les noms (souvent absurdes) des vêtements des pièces de prêt-à-porter. Le lecteur est entraîné dans un équilibre précaire entre notre époque, celle d’avant, des autres et leurs propres rêves.
Le livre manque certes de profondeur, mais pas de matière. Les épisodes autobiographiques, qui mêlent histoire et politique, mériteraient un ouvrage à eux seuls. On y suit alors l’arrivée et les galères de ces étudiants congolais, sénégalais ou ivoiriens à Paris, et répartis dans des résidences par nationalité. De bronze, d’or où de plomb, ces âges de l’immigration sont aussi ceux de la société française : la décolonisation, les crises économiques, le tournant psychotique du 11-Septembre. Mais c’est bien là le charme de ce récit : celui, maladroit, d’un balancement entre deux mondes, trois générations, plusieurs quotidiens. Gauz ne résiste pas non plus à ces fulgurances rancunières – « La République se branle » – envers une France toujours plus sécuritaire, toujours plus sectaire aussi. Et c’est une juste mise en abîme qui nous y amène, celle de ces vigiles noirs, habillés en noir, qui surveillent d’un œil leurs clients tout en surveillant de l’autre le véritable Big Brother : les lois, l’administration, la régularisation. Car dans un monde où chacun veut voir et être vu, l’auteur rend aussi un hommage à la fois lucide et rare sur ces communautés silencieuses, dans l’angle mort de la vigie républicaine, mais bien trop souvent sous les feux de ce triste constat : « On ne gère que le sentiment d’insécurité ».
Debout-Payé, de Gauz
Le Nouvel Attila, août 2014
192 pages, 17 euros
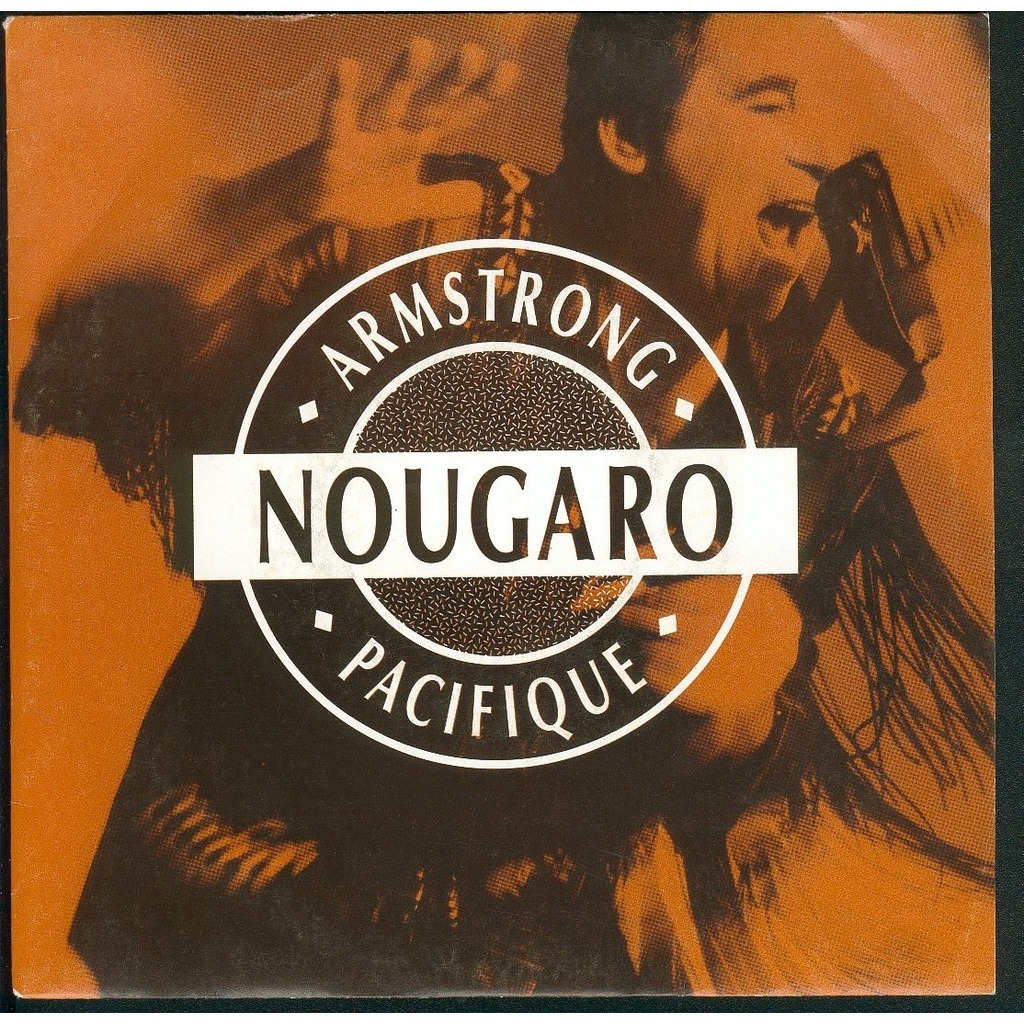 Le 18 novembre, la conseillère municipale UMP de Combs-la-Ville, Claudine Declerck, a démissionné après avoir partagé sur son compte Facebook une caricature de Christiane Taubira intitulée « Y’a pas bon Taubira », en référence à la célèbre publicité néocolonialiste (Le Monde, 18/11/2013).
Le 18 novembre, la conseillère municipale UMP de Combs-la-Ville, Claudine Declerck, a démissionné après avoir partagé sur son compte Facebook une caricature de Christiane Taubira intitulée « Y’a pas bon Taubira », en référence à la célèbre publicité néocolonialiste (Le Monde, 18/11/2013).Cet épisode est à l’image des comportements racistes auxquels la société française est confrontée depuis plus d’un mois déjà. Christine Taubira, garde des Sceaux, en est le symbole : elle a fait les frais d’agressions verbales dégradantes et offensantes. Les langues se délient et certains n’ont désormais plus honte de s’attaquer à une ministre, de la Justice, qui plus est.
Le 17 octobre déjà, Anne-Sophie Leclere, alors candidate du Front national à Rethel (Ardennes) pour les municipales de 2014, intervient dans l’émission Envoyé Spécial consacrée aux « nouveaux visages » du FN. Interrogée sur un photomontage publié sur sa page Facebook y représentant Christiane Taubira à côté d’une photo d’un jeune singe, la militante s’est justifiée en assurant que cette image n’était pas raciste. Selon la candidate FN, « ça n’a rien à voir, un singe reste un animal. Un Noir, c’est un être humain ». (Jdd, 18/10/2013). À croire qu’en plus d’une subtilité douteuse dans la métaphore filée par Leclere, celle-ci cherche à se défendre d’une logique tout aussi hasardeuse. Le couperet tombe dès le lendemain avec sa suspension. Florian Philippot, vice-président du FN, évoque une « erreur de casting ».
On sait les citoyens touchés par le scepticisme à l’égard du gouvernement en place. En témoigne la manifestation organisée par l’association « catholique intégriste » Civitas, le 20 octobre à Paris, en réaction aux propos de Pierre Bergé ayant affirmé sur RTL son désir de voir supprimer toutes les fêtes chrétiennes du calendrier. Criant à la « cathophobie », la manifestation s’est rapidement transformée en un véritable cirque du « tous pourris » en s’échauffant sur les francs-maçons avant de s’attaquer à Christine Taubira, du fait de son rôle dans l’instauration de la loi sur le mariage pour tous, via la voix de l’Abbé Xavier Beauvais qui entonne un tonitruant « Y’a bon Banania, y’a pas bon Taubira ». Les images de cette injure seront reprises par le Petit Journal dans une séquence vidéo intitulée « La manif qui sent bon la pastille Vichy ». Tout est dit.
Cinq jours plus tard, la contamination est avérée. En déplacement à Angers, la ministre se fera insulter devant le palais de justice, cette fois-ci par des enfants. Pensant par ce geste ignoble suivre les sages idées de ses parents, une fillette brandit la « banane de la discorde » en traitant Christiane Taubira de « guenon », ce qui lui vaudra un billet aussi cinglant que poétique de la part du chroniqueur de France Inter, François Morel. L’incident fait l’objet d’une question à l’Assemblée, le malaise est présent, mais on hésite encore à donner trop d’importance au sujet. Risque de médiatisation excessive du racisme ? Pourtant, les consciences s’éveillent et les contre-discours s’affirment comme dans le cas de Harry Roselmack qui s’interroge, dans une tribune, sur le retour du racisme en France.
Il faut attendre la Une de l’hebdomadaire Minute du 13 novembre – sur laquelle on peut lire « Maligne comme un singe, Taubira retrouve la banane » – pour que naisse un soutien quasi unanime. Pendant que Jean-Marc Ayrault saisit le procureur de la République de Paris, Manuel Valls, annonce que le gouvernement étudie « les moyens d’agir contre la diffusion du journal ». Du côté des intellectuels, l’écrivain Marie Darrieussecq a dédié son prix Médicis à la ministre de la Justice alors que plusieurs personnalités – dont l’historien Benjamin Stora et l’actrice Jeanne Moreau – ont cosigné une tribune intitulée « Nous sommes tous des singes français » afin de dénoncer l’ « infâme » Minute.
Enfin, si Marine Le Pen a qualifié d’un « archi-nul » la Une de Minute, elle n’a pu s’empêcher d’attaquer Christiane Taubira sur le fait qu’elle serait « anti-française », point sur lequel le père de la présidente du FN semble (enfin) s’accorder. Face à l’hypocrisie d’une extrême droite qui prétend « mépriser » le racisme tout en continuant de jouer les néocolonialistes en fustigeant le passé indépendantiste de Christiane Taubira, laissons à la principale intéressée le soin de conclure. Lors de la journée du 16 novembre que la scène du TARMAC a consacrée à Frantz Fanon, la ministre de la Justice a clamé – 52 ans après la parution des Damnés de la Terre – que le racisme « a forcément recours au bestiaire, il évoque la réputation du jaune, les hordes, les grouillements. […] Ces gens-là, décidément, n’ont pas d’imagination. Voilà pourquoi ils sont déjà vaincus. Mais nous devons non seulement les vaincre, mais le leur faire savoir. Il faut qu’ils sachent qu’ils sont vaincus, du passé, déjà finis, dévitalisés, desséchés ». Lors d’un rassemblement contre les extrémismes organisé par le PS à la Mutualité le 27 novembre, Manuel Valls a affirmé que Christiane Taubira et lui-même formaient un « beau couple ».
Face aux attaques portées contre la République, le ministre de l’Intérieur a réaffirmé la « force de l’état de droit » qu’il incarne auprès de la ministre de la Justice. Lors de ce meeting, la garde des Sceaux a été ovationnée et a répondu à ceux qui l’avaient attaquée : « Ils commencent par vilipender les apparences, ils commencent ainsi par la différence qu’ils voient et ils finissent par celle qu’ils imaginent. Et ils mettent tout le monde et chacun en danger.» Et après avoir prononcé un plaidoyer poignant pour la défense de la République et de son école, Christiane Taubira a clamé derechef qu’elle continuera de « barrer la route » aux « racistes, antisémites et xénophobes ».
Après cette mobilisation politique, ce fut au tour du monde de la culture d’organiser une soirée contre le racisme au théâtre du Rond-point, le 2 décembre dernier. Là encore, une poignée de militants d’extrême droite attendait Christiane Taubira dans le seul but de la conspuer. En dépit de quelques sifflets, la ministre a rappelé que sa personne comptait peu et que son « inquiétude profonde » était pour ces millions de personnes que compte le pays et qui sont de nouveau affectées par ces violences. A l’intérieur du théâtre, la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, est présente auprès de Harlem Désir, le premier secrétaire du Parti socialiste, ainsi que de Valérie Trierweiler. A leurs côtés, des acteurs, musiciens et humoristes sont là pour soutenir la ministre de la Justice. L’humoriste Guy Bedos y a résumé la tâche difficile du combat contre le racisme avec un bagou et une crudité verbale qu’on lui connaît bien : « Il faudrait un traitement médical contre la connerie ! Parce que le racisme, c’est de la connerie ! ».
Contre le racisme et pour l’égalité des droits
(déclaration de Fabienne Haloui, membre du comité exécutif national du PCF, responsable du secteur droits et libertés.)
C’était il y a 30 ans, jour pour jour. Le 3 décembre 1983, près de 100 000 manifestants défilaient de la place de la Bastille jusqu’à Montparnasse, 1 mois ½ plus tôt une trentaine d’enfants d’immigrés et de militants anti racistes étaient partis de Marseille en décidant de marcher dans la voie de Martin Luther King. Victimes de violences racistes, maintenus dans l’invisibilité, ces jeunes, fils et filles nés sur le sol français de parents immigrés, ont choisi alors une action pacifique pour demander ce que la République leur refusait : l’égalité. Aujourd’hui, force est de constater que le combat est loin d’être gagné. Les attaques abjectes contre Christiane Taubira et le racisme ordinaire subi par des millions de Français anonymes nous démontrent qu’il ne faut jamais baisser la garde.
Trente ans après, sur fond de crise économique, malgré certaines avancées, un constat s’impose : notre société n’a pas traité ses enfants à égalité. A situation sociale égale, les enfants et petits enfants d’immigrés du Maghreb et d’Afrique subsaharienne sont plus discriminés. La couleur de leur peau et leur patronyme en font des éternels immigrés ! Français à 97 % ils se sentent toujours perçus comme des «issus de », et à 67 %, ils pensent que « le regard des autres ne fait pas d’eux des Français ». Rien d’étonnant puisqu’un Français sur trois conteste leur appartenance à la nation.
Au nom d’une France mythique, mais irréelle, les théoriciens du choc des civilisations identifient la menace, une immigration de masse et un nouvel ennemi de l’intérieur, le musulman. Ils déplacent ainsi la question sociale sur le terrain identitaire favorisant le développement d’un racisme culturel, largement banalisé par la mandature Sarkozy, un racisme décomplexé et assumé comme en attestent les propos tenus sur les Roms ou les musulmans.
La lutte contre le racisme passe par la conquête de droits pour rétablir l’égalité entre toutes et tous. Le gouvernement doit donner l’exemple en déclarant la lutte contre le racisme et les discriminations, grande cause nationale, en produisant des actes concrets pour l’égalité parmi lesquelles : le droit de vote des résidents étrangers, la mise en place d’un récépissé contre les contrôles au faciès, la régularisation des sans-papiers. La réalisation d’un travail de mémoire et d’histoire critique sur la colonisation et les migrations est aussi indispensable : vieux pays d’immigration, pluriel, métissé, multiconfessionnel la France ne se représente pas et ne s’assume pas comme tel. Ouvrons ce débat ! La France est la France lorsqu’elle fait vivre ses valeurs de liberté d’égalité et de fraternité n’en déplaise à Jacques Bompart, maire d’Orange qui considère que les inégalités sont naturelles et qu’il faut donc les respecter. La France n’est pas celle des nostalgiques de l’ordre colonial n’en déplaise à Jacques Bompart qui s’apprête à baptiser une avenue du nom d’un partisan de l’Algérie française. C’est avec la France telle qu’elle est dans sa diversité que nous devons inventer la société du vivre ensemble, solidaire, laïque, fondée sur l’égalité des droits pour tous, le refus des discriminations, le respect de l’altérité culturelle, la citoyenneté de résidence, la valorisation de la culture du métissage.

L’arrestation de Jang Song Thaek – l’oncle par alliance de Kim Jong Un et numéro 2 officieux du régime – en pleine réunion du bureau politique du comité central du Parti du travail de Corée (PTC) dimanche 8 décembre, avait déjà soulevé de nombreuses interrogations. Après avoir été jugé par un tribunal militaire spécial, le vice-président de la Commission de défense nationale aurait été exécuté « à la mitraillette », jeudi 12 décembre, pour avoir commis des « actes criminels » et dirigé une « faction contre-révolutionnaire », selon l’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.
Faut-il y voir une réponse à un acte de « trahison » d’un oncle présenté comme étant « le garant de l’adhésion de l’armée derrière le nouveau leader » et l’« l’homme de Pékin » ou la volonté d’affirmer l’absolutisme du pouvoir de Kim Jong Un en éliminant l’influence d’un oncle qui lui aurait fait trop d’ombre ?
S’il est encore un peu tôt pour le savoir, il est en revanche possible d’observer, à travers l’exécution de Jang Song Thaek, l’éviction d’un des derniers hommes de la vieille garde et une vigoureuse reprise en main de l’armée et de l’appareil du PTC.
Si « la puissance politique se développe hors du baril d’une arme à feu », on oublie souvent de rappeler l’intégralité de la citation de Mao Zedong qui finit par cette injonction : « Et le Parti doit commander aux fusils ».
Anthony Maranghi
Le « Jour de colère » du 26 janvier à Paris a surpris et choqué : en brisant les lignes, en franchissant les opportunismes militants qui jusqu’alors avaient le mérite d’isoler les mouvements extrémistes, il a réuni en son sein des individus aux propos xénophobes, anti-mariage pour tous ou antisémites. On explique, comme Henri Vernet, que les propos tenus à l’encontre de la société dans son ensemble ont débordé des cadres du « réseau des réseaux », ceux d’Internet (Le Parisien 29/01). Youtube et Facebook n’ont pas le monopole de la parole publique : c’est toujours la rue qui gagne. Si les milliers de manifestants ont « surpris par la violence de leurs slogans », ils fragilisent aussi les contre-discours : la diversité dans leurs rangs allant des musulmanophobes et des musulmans, aux « Hommen » ou même au « camping pour tous ». Si Le Parisien relativise ainsi la force et la portée du mouvement, il n’en reste pas moins vrai que ces protestations de colère sont un signal d’alarme, annonciateur du « virage » à droite du gouvernement et, plus encore, de la radicalisation décomplexée de toutes les droites.
Les attaques en règle contre la volonté du gouvernement de briser les tabous du genre, le fantasme islamiste, la multiplication – brouillée – des boucs émissaires, l’implication d’enfants dans un microcosme de fureur désinhibé : la semaine suivant « le Jour de colère », Farida Belghoul, ancienne pionnière de « la Marche des Beurs », décrétait l’instauration des « Jours de retrait de l’école », visant à priver les enfants d’un droit, mais aussi d’un devoir inscrit dans le code de l’éducation. Et comme il ne fallait rien lâcher, c’est « la Manif pour Tous » qui a renchéri le 2 février, pour agiter l’épouvantail de la « familiophobie » du gouvernement. Cette seconde édition a donc remis le couvert, en dénonçant la « politique fiscale défavorable aux familles », la « réduction du congé parental », la peur d’un « retour de la PMA dans la loi famille », la reconnaissance de la gestation pour autrui (GPA), le « statut du beau-parent », ou encore l’instauration de « la prémajorité, qui restreint l’autorité parentale », comme l’explique Marine Turchi dans Mediapart (03/02). Le parallèle est de mise entre cette manifestation et « la Marche pour la vie » du 19 janvier, d’autant plus vigoureuse cette année face à la suppression de la notion de « détresse » par le gouvernement dans la loi sur l’IVG, et à côté de laquelle celle organisée en soutien aux femmes espagnoles et au droit à l’IVG a tristement fait pâle figure au sein des média.
Quand la rue passe l’arme à droite
En revanche, il faut ici distinguer l’opposition à la loi Taubira du 17 mai 2013, qui a convaincu le gouvernement d’ajourner le projet de loi sur la famille, de l’hétérogénéité, de l’incohérence des participants au « Jour de colère » du 26 janvier. Le 14 janvier (Slate.fr), Vincent Glad analysait l’appel fait au « Jour de colère » en comparant ses membres avec le phénomène des bonnets rouges, « en réunissant patrons, syndicalistes, agriculteurs et régionalistes, ont ouvert la voie à une nouvelle forme de mobilisation : […] faire reculer le gouvernement ». Selon Louis Dumont, l’un de ses organisateurs et interrogé par le site conservateur et libéral « Nouvelles de France », le 22 novembre 2013, le mouvement n’a ni leader, ni porte-parole, contrairement à « la Manif pour Tous ». Cette dernière qui aspire à imposer une certaine vision traditionnelle, patriarcale et sexiste de la société, nie et refuse d’accepter les mutations à la fois concrètes et cognitives des mœurs de ses concitoyens. Ironie du sort : les solidarités primaires, elles aussi, souffrent des excès de l’individualisme propre à notre époque. En revanche, « le Jour de Colère », lui, représente « des millions de Français qui ont été méprisés systématiquement par ce gouvernement ainsi que par la plupart des média à chaque fois qu’ils essayaient de faire entendre leurs voix », selon Louis Dumont. La « coagulation » est leur mot d’ordre. Bien triste issue pour une société déjà éclatée, qui n’a pas eu ses indignés, contrairement à l’Espagne ou à la Grèce : Jean Birnbaum, dans Le Monde (01/02), remarquait ainsi que la colère ne faisait pas une politique, qu’elle est l’indignation amputée de son espérance. Le constat d’un peuple français uni autour d’un sentiment si peu constructif est fait. Personne ne nous volera notre Révolution, si elle est tuée dans l’œuf par ces « jours de colère » aveugles à tout espoir, à toute vision de progrès pour la société.
Le 6 février dernier, certains ont rappelé le triste anniversaire des mobilisations anti-gouvernementales formées de groupuscules d’extrême droite et d’inspiration fasciste en 1934. Patrick Le Hyarick souligne dans son blog (06/02) que « Paris n’avait pas brui de slogans antisémites aussi violents tels : « dehors les juifs », depuis l’occupation nazie ». Le Huffington Post (27/01) décrit, sous la plume de Geoffroy Clavel, comment Yvan Benedetti, chef de file du groupuscule pétainiste, aujourd’hui dissous, « L’Œuvre française », avait « fièrement défilé en scandant “Travail, famille, patrie” avant de tenter de s’approprier le micro en fin de cortège ». L’article, qui cite le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), souligne ainsi comment cette manifestation « agrégeait dans la même haine antirépublicaine, les chrétiens intégristes homophobes et les nationalistes racistes musulmanophobes ».
« La peur ne fait pas une politique »
Dans Le Monde (05/02), Jean-Baptiste de Montvalon revient sur certains moments politiques de l’Histoire où les gouvernements se sont risqués au changement, parfois même au progrès social, au risque de s’attirer les ires d’une société qui n’y était pas préparée, voire totalement opposée. Car si la politique est bien une affaire de vision d’un certain idéal commun, elle est aussi le fait de choix, de convictions individuelles voire égoïstes qui font que Machiavel est toujours d’actualité. L’abolition de la peine de mort, dont certains réclament encore aujourd’hui le rétablissement, reste pour de nombreux analystes le symbole à part entière d’un acte politique détaché de l’opinion publique et des ambitions électoralistes. Il faut ici souligner que les revendications formulées clairement par les organisateurs des manifestations extrêmistes ont permis le recul du gouvernement, humiliant la ministre chargée de la famille et démontrant aux électeurs de gauche déçus, qu’à défaut de les écouter, ce pouvoir défait ses propres lois. À l’inverse, comme le répète Serge Halimi dans Libération (05/02), « La peur n’est pas une politique ». De même que la colère.
Dominique Reynié, dans Le Figaro (07/02), souligne, au-delà du mutisme socialiste caractéristique des blocages internes au parti, que si « La France a des institutions démocratiques […] elle manque de culture démocratique ». L’empressement affiché de Manuel Valls à criminaliser, à dénigrer chaque manifestation ou mouvement social avant même qu’il ne se produise (rappelons-nous déjà comment le ministre de l’Intérieur s’était rangé aux côtés des forces de police avant l’organisation de manifestations pro-Dieudonné), fait ainsi de la liberté d’expression – populaire, qui plus est – un marqueur de transgression qui ne doit pas nous laisser indifférents. Sur France 2, dans l’émission « Mots Croisés », Pierre Moscovici lançait à Marine Le Pen : « Vous n’avez pas le monopole du peuple ». Une bien pauvre défense quand on voit à quel point la gauche est en train de le perdre, quand elle finit par se coucher devant l’autel du conservatisme, en enterrant de fait le projet de loi sur la PMA. Jack Dion, dans un article de Marianne (07/02), affirme que « comme Tony Blair ou Gerhard Schröder avant lui, François Hollande est rentré au bercail de la bien-pensance, fermant une boucle ouverte par François Mitterrand dès 1983, avec le tournant de la rigueur. Le candidat Hollande avait pourtant l’avantage d’un diagnostic simple et partagé par la majorité de ses électeurs : « l’ennemi, c’est la finance ». Mais lorsque la crise sociale ne vient pas, comme le précise Dion, de l’inaboutissement de « promesses irresponsables formulées en période électorale et impossibles à appliquer », mais bien « d’un diagnostic juste non suivi d’effets concrets ou de décisions adaptées », on assiste alors au paroxysme d’une politique contre-productive faisant le lit de son propre discrédit. Face aux manifestations « de droite », ce sont les membres de l’UMP comme du PS qui sont mis en difficulté. Les premiers veulent éviter deux écueils, comme l’écrit Isabelle Ficek dans Les Échos (06/02) : l’ignorance (donc l’abandon d’un électorat potentiel) et la récupération maladroite, pouvant mener à la surenchère, illustration tannée d’une stratégie politique désormais commune aux deux partis majoritaires, désarmés face à la montée du FN.
Le peuple de gauche, lui aussi, a le droit (et le devoir) de s’exprimer et de faire bouger les lignes. À ceux qui abandonnent l’indignation pour la colère ou pire, la résignation, il est temps de prendre conscience que ces manifestations sont à la fois liberticides et dangereuses pour notre avenir à tous. Les plus réfractaires au progrès social, qui semblent être les seuls à recevoir un écho de la part du gouvernement, en viennent à menacer nos droits les plus élémentaires et les plus fondamentaux comme le droit à l’avortement, à l’abolition de la peine de mort ou à s’unir librement. Le droit de vote des femmes lui-même, véritable pierre angulaire de notre passage à la démocratie (selon Cohn-Bendit) ne fut que tardivement adopté à l’issue de la Seconde Guerre mondiale. N’oublions pas Clément Méric, les femmes espagnoles, ne laissons pas les luttes du passé, et leurs succès, aux mains des conservatismes fondamentalistes et patriarcaux qui menacent nos acquis sociaux.
Une exégèse peu rassurante
«Des voeux de combat et d’avenir», avaient promis les proches de François Hollande à l’occasion de l’allocution télévisée du président de la République le 31 décembre. Alors que le couperet des derniers chiffres de l’emploi venait de tomber, annonçant officiellement l’échec de la promesse d’inverser la fameuse courbe du chômage avant fin 2013 (En novembre, 17 800 demandeurs d’emploi sans activité supplémentaire), le président et son équipe ont martelé être sur la bonne voie. N’en déplaise à ceux qui ne «le perçoivent pas», comme le suggérait Benoît Hamon dans l’émission « Tous Politiques » sur France Inter le 5 janvier, François Hollande a donc abattu ses cartes lors du réveillon. Au coeur du discours, qui a repris l’ensemble de l’aventure française de 2013 (l’Afrique, l’Europe, la crise, la réforme des retraites, l’éducation, le mariage pour tous, etc.), il a annoncé la mise en place d’un pacte de responsabilité entre l’État et les entreprises, résumé ainsi: « moins de charges et moins de contraintes sur l’activité », contre « plus d’embauches et de dialogue ». Si la dernière contrepartie était déjà logiquement présente dans le programme du candidat en 2012, la première, en revanche, a suscité grincements de dents et surprise de la part de la gauche comme de la droite. Ainsi, l’ex-ministre de l’Ecologie Delphine Batho, libérée des carcans de la communication gouvernementale, s’est étonnée que « l’évolution du président vers une ligne « social-libérale » ne soulève pas davantage de critiques » au sein de la majorité. (JDD, 4/01/2014). Et Jean-Pierre Raffarin de s’amuser « C’est vrai que François Hollande nous a fait des voeux relativement à droite ».
En proposant la fin des cotisations familiales patronales, le président de la République a répondu à une vieille exigence de classe du Medef et fait un nouveau cadeau de 30 milliards au patronat après les 20 milliards du Cice (Crédit d’impôt compétitivité pour les entreprises). Aucune mention n’a été faite des «contre-parties» incluant le paquet surprise du chef de l’État, si l’on exclue les négociations de branche. Sans surprise, le président du Medef Pierre Gattaz a salué «le plus grand compromis social depuis des décennies», affirmant au passage que ce discours allait «dans le bon sens», et qu’il témoignait d’une «prise de conscience de la réalité de la France» (Le Figaro, le 15/01/14).
Le « tournant » de Hollande avait déjà été débattu après ses voeux du 31 décembre. Mais quel tournant ? Celui d’un socialiste vers la social-démocratie, ou bien celle, plus radicale comme aiment à nuancer certains, d’un socialiste «mou» vers le social-libéralisme ? En tout cas, il s’agit bien «d’une accélération», «d’un approfondissement» de la politique menée, selon certaines déclarations de ministres du gouvernement début janvier. De façon plus insidieuse, certains ont confirmé qu’il «assumait». Mais quoi, au juste ? Pour un proche (anonyme) du président, interrogé par le JDD, c’est la mutation similaire à celle «de 1984 ou de 2000, la logique sociale-libérale», que François Hollande assume. Et pourtant, à l’issue de son discours, interrogé sur sa politique économique, il a encore clamé ne pas s’être engagé vers la voie libérale, pourtant bien clairement affirmée dans ses annonces.
Du coté des réactions de la presse, le doute est, en revanche, moins présent. Excepté la presse d’opinion du courant de l’opposition (Le Figaro), tous s’accordent à affirmer, ou à avouer, selon les réticences, le virage tant annoncé.
Rupture, décalage ou coming out ?
A l’occasion des 150 ans du SPD, le parti social-démocrate allemand, à Leipzig, François Hollande avait déjà suscité des avis partagés en louant les réformes du marché du travail menées en Allemagne par l’ancien chancelier social-démocrate Gerhard Schröder : « Le plus grand démantèlement social qu’ait connu l’Allemagne depuis l’après guerre », déplorait alors Thomas Nord, député du parti Die Linke (gauche radicale) au Bundestag (Libération, 23/05/2013). Puis, ce sera au tour du Pacte de Compétitivité, annoncé en novembre 2012, d’inquiéter, de révolter, mais sans pour autant faire s’esquisser dans les esprits l’idée d’un changement radical de politique. Question de visibilité, sûrement. La médiatisation des voeux du Président expose donc ici clairement ce que Hollande essaie de nous faire comprendre depuis près de deux ans déjà. Pourtant, la technique est osée: l’annonce du Pacte de Responsabilité est formellement bancale: d’un côté, « moins de contraintes sur les activités » ; de l’autre, « plus de dialogue social ». Selon Le Monde, ces deux derniers éléments, non quantifiables, ne se situent pas – ou pas seulement – dans le registre des externalités que les entreprises sont censées prendre en charge (du fait de leur «responsabilisation»). En somme, s’il est bien explicite que les entreprises seront de nouveau privilégiées et mises au coeur des efforts de l’État, rien n’est clairement dit sur les conditions du dialogue social, de ses acteurs ou de ses objectifs (Le Monde du 9 janvier 2014). A croire que ce dernier, censé être au coeur de tout discours socialiste, ne sert qu’à appuyer la timidité du Président à afficher son libéralisme.
L’UMP n’en mène pas large, malgré le scepticisme déclaré de ses membres quant à l’application du Pacte. Et cela n’est pourtant pas pour réjouir les sympathisants socialistes: car en assumant une politique sociale-démocrate, voire sociale-libérale, le président a coupé l’herbe sous le pied de l’opposition. Moins de charges sur les entreprises, moins de dépenses publiques, moins d’impôts… Le nouveau programme économique de Hollande dame le pion à la droite, dans une similitude évidente avec les voeux de M. Copé du 30 décembre: « Il est urgent de baisser drastiquement les impôts, les charges sociales et la dépense publique, de supprimer sans trembler toutes les réglementations absurdes » (Le Monde, 7/012014).
Le «tournant» annoncé doit donc s’analyser à deux niveaux: le premier est celui qui oppose la période où François Hollande était encore candidat à l’élection présidentielle et celle d’aujourd’hui. À ce premier degré, il y a bien une rupture entre l’annonce et les pratiques. Ainsi, pour Elie Cohen, qui répond au Monde, le 8 janvier 2014: « les choix politiques affichés par le président lors de ses vœux sont en rupture par rapport à ceux qu’il a faits depuis son élection», évoquant l’augmentation des impôts ou la réduction des dépenses publiques. En revanche, rien à dire sur la continuité des pratiques avec le discours du candidat Hollande aux primaires socialistes de 2011: à l’époque, rappelle l’économiste, l’ancien secrétaire du PS avait focalisé son programme sur la résorption de la dette, plaidant pour un rééquilibrage des comptes publics plus rapide et radical que celui proposé par le PS. Il défendait enfin déjà l’idée d’un « pacte productif », n’hésitant pas à se présenter, dans son livre Le Rêve français (Privat, 2011), en promoteur de « l’esprit d’entreprise ».
Il semble donc acquis que les paroles et les actes ne collent pas. Mais faut-il vraiment parler de « tournant », voire de virage « social-démocrate » ou n’est-ce pas tout simplement l’affirmation d’une synthèse social-libérale faite lors de sa conférence de presse du 14 janvier ? Il n’était pas nécessaire d’attendre cette épiphanie télévisuelle pour se rendre compte que l’argument de la « rupture idéologique » ne tient pas. Il était pourtant clair que François Hollande ne s’inscrivait pas dans la lignée d’« un Jaurès ou d’un Blum » (Le Monde, 8/01/2013). Dépassons donc un débat stérile, qui n’est au fond qu’une vaine tentative pour masquer l’adhésion du socialisme aux valeurs libérales, s’inscrivant de fait dans le droit chemin qu’avait déjà pris François Mitterrand en 1983.
Quand la gauche « bougeait »…Il y a trente ans
Il faut remonter aux années 1980, aux premiers pas de François Hollande en politique, pour comprendre les origines du discours libéral de ce dernier. Dès sa sortie des bancs de l’ENA, au sein de la célèbre «promotion Voltaire» (1980), il s’engage modestement dans la campagne présidentielle de 1981 – en temps que jeune auditeur à la Cour des comptes – pour l’Union de la Gauche. Après l’élection de François Mitterrand, le 10 mai 1981, et deux premières années de présidence marquées par la nomination de ministres communistes et de quelques nationalisations, 1e plan de rigueur de 1983 marque un premier « tournant » dans la conversion du Parti socialiste à l’idéologie néolibérale, marquant la naissance du consensus des socialistes autour d’une gauche se qualifiant de « moderne ».
C’est dans un ouvrage collectif tombé dans l’oubli, aujourd’hui « épuisé » et volontairement non réédité, que se trouve l’embryon idéologique de l’actuel « tournant social-démocrate ». C’est en relisant La Gauche bouge (publié en 1985 aux éditions Jean-Claude Lattès), qu’on peut observer comment François Hollande prônait ouvertement le libéralisme (sous le pseudonyme de Jean-François Trans), aux côtés de Jean-Pierre Jouyet, ancien camarade de promotion, et de ceux du mouvement « Trans-courants » interne au PS (Jean-Michel Gaillard, Jean-Yves Le Drian et Jean-Pierre Mignard). Les cinq jeunes cadres du Parti Socialiste affichaient tous une ambition politique claire : la création d’une «troisième voie» basée sur l’acceptation de l’économie de marché mondialisée et «une réflexion progressiste coupée de tout courant idéologique». Dans le contexte des politiques néolibérales d’alors, il semblerait qu’une politique économique de gauche, fondée sur une relance par la demande, ne correspondait plus à la vision de ce mouvement qui se disait alors aussi attentif « au progrès social qu’à l’efficacité économique ». On peut ainsi lire dans l’ouvrage que « ce n’est pas par calcul ou par malignité que la gauche a accepté de laisser fermer les entreprises ou d’entamer le pouvoir d’achat des Français. C’est par lucidité. Refuser ces évolutions et c’en aurait été fait de la perspective d’une gestion régulière du pays par la gauche » (La Gauche bouge, p.53).
Le mouvement « Trans-courants » a alors créé le club politique « Démocratie 2000 », avec quelques autres personnalités comme Jean-Pierre Jouyet et Ségolène Royal, afin de revendiquer, selon son ancien trésorier François Silva, une « certaine social-démocratie à la française » (Blog de Sylvain Rakotoarison, 19/05/2007). Choisissant Jacques Delors comme président honoraire dès sa fondation, les membres du club projetèrent de « faire bouger les lignes figées », à l’instar de la polémique sur la construction européenne (d’où l’adhésion de François Hollande au Traité de Rome de 2004 n’ayant, in fine, pas été ratifié). Par la suite, le refus de Jacques Delors de participer aux élections présidentielles de 1995 et la victoire de Lionel Jospin aux législatives de 1997 marquèrent la fin des « Trans-courants ». Certains se rapprochèrent du Premier ministre de la troisième cohabitation ou de Dominique Strauss-Kahn, et d’autres se tournèrent vers la députation. Ce retour surprise de la gauche au pouvoir a permis à François Hollande de se faire oublier en retrouvant son siège de député et en étant choisi comme premier secrétaire du Parti Socialiste de 1997 à 2008, selon le souhait de son prédécesseur Lionel Jospin. Durant cette dizaine d’années, il se présentera aux européennes de 1999 et à la mairie de Tulle en 2001 et 2008, qu’il gagnera, et soutiendra son ex-femme Ségolène Royal pour les élections présidentielles de 2007. Mais durant toute cette période, il restera assez effacé, son rappel de l’adoption par le Parti Socialiste de l’économie de marché, lors de son discours pour le centenaire du parti en 2005, affirmant que c’était la forme « la plus efficace » de création de richesses (Le Figaro, 14/12/2007).
Le 26 novembre 2008, lors du Congrès de Reims, François Hollande, remplacé à la direction du Parti Socialiste par Martine Aubry, commence à préparer son programme pour l’élection présidentielle de 2012. Alors qu’il n’était que le n°2 derrière Dominique Strauss-Kahn, archi-favori des sondages, François Hollande faisait peu parler de lui mais avait déjà choisi son camp idéologique. En témoigne le choix du nom de l’association qu’il créera avec Jean-Marie Cambacérès, autre camarade de la promotion Voltaire, « Démocratie 2012 ». Ayant pour but de « rassembler la Gauche et les forces de progrès » (Démocratie 2012, 9/01) au nom de la social-démocratie, elle était pourtant un signe avant-coureur de l’accord des socialistes actuels avec le libéralisme mondialisé. Citons toujours Hollande, alias Jean-François Trans, au milieu des années 1980 : « Il ne s’agit plus d’assurer la représentation politique de la classe ouvrière alors que les catégories sociales perdent en cohésion et que le salariat s’est profondément recomposé, ou de renforcer encore l’État-providence alors que celui-ci parvient de plus en plus difficilement à se financer et que les risques traditionnels sont correctement couverts ».
Finalement, le libéralisme de François Hollande n’a jamais faibli, en trente ans de carrière politique. Suite aux multiples abandons des salariés d’Arcelor Mittal ou de Florange, entre autres, au bénéfice des entrepreneurs, ce « Pacte d’irresponsabilité sociale », dénoncé par Pierre Laurent dans l’Humanité le 15 janvier, a définitivement fait tomber le masque socialiste, qui ne doit plus tromper personne, et a affirmé la politique libérale menée par le président et son gouvernement.
C’est une histoire au nom si étrange et long qu’elle tente aussi bien qu’il dérange. La couverture, aux couleurs d’Ikea, séduisant et suédois conquérant du monde moderne, atterrit sur nos tables, gaie comme un tapis «Gulört». La forme invite au sourire, qui s’étend avec le nom de l’histoire, tendre et perchée. Celle des aventures pittoresques d’un mystérieux indien, Ajatashatru Lavash, fakir de son état, et non de profession, donc, puisqu’il n’en restera pas là. Ce dernier, qui s’envole pour Paris afin d’acquérir un lit à clous, tombera sur deux fautes de goût nationales: un magasin Ikéa et un méchant contrôle de passagers clandestins à Calais, et qui aura tôt fait de le réexpédier vers un pèlerinage méditerranéen rocambolesque. La suite du périple sera semée d’embûches et de rencontres, au coeur desquelles ces héros de l’ombre, victimes pour les ONG, cibles ou menaces pour les autorités: les clandestins. L’indien observe, découvre, médite et frôle la surface du miroir de l’Occident, entre son rêve de troquer le turban contre une plume, et un réel ébouriffant. Et le charme y est, en une sorte d’initiation à la cruauté bizarre -mais logique puisque globish– de notre antique obsession des frontières. On y retrouve un peu de l’Hector naïf mais éclairé de François Lelord, qui lui recherchait le bonheur. Ajatashatru lui, trouve dans ce périple plusieurs chemins vers l’Autre, qui finiront par le mener ailleurs qu’à Rome, mais ça, c’est bien la même histoire, et il serait dommage de ne pas la lire.
L’Extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikéa, de Romain Puértolas
Cette année fut marquée par l’accession de l’Argentin Jorge Mario Bergoglio à la tête du Vatican, et désormais plus connu sous le nom de «pape François» (premier du nom et 265e successeur de l’apôtre Pierre). Il a fait figure, depuis son élection le 13 mars, d’un progressisme et d’un socialisme jusqu’alors affaiblis par certaines représentations de l’Église la montrant comme une institution sclérosée, conservatrice et représentative de la domination du «Nord» sur les pays «du Sud».
Tout récemment élu « personnalité de l’année » par le magazine Time, le pape François incarne désormais une « Eglise des pauvres », celle qui réussirait, au nom des fondements chrétiens de la miséricorde et du rapprochement avec les populations marginalisées, à » capturer l’imaginaire de millions de personnes qui avaient cessé d’espérer quoi que ce soit de la part de l’Église « , selon la revue. Le pape a ainsi prononcé, à l’occasion de son premier Noël à la tête du Vatican, sa bénédiction urbi et orbi, le 25 décembre, sur la place Saint-Pierre à Rome, devant près de 10 000 personnes. Il a notamment délivré un message de paix et de dialogue, en appelant à la fin des conflits en Afrique et au Moyen-Orient. Il a souligné l’importance de l’aide humanitaire en Syrie, et du sort des enfants et des migrants victimes des conflits, appelant au passage, selon France Info, au respect de l’environnement. Vaste programme.
Un discours critique sur les conséquences du libéralisme actuel
Portant le projet d’une Église « pauvre, humble, dépouillé des attributs du pouvoir, qui dialogue avec le peuple », le nouveau Pape, associé par certaines analyses hâtives à la « théologie de la Libération », porte ainsi un discours critique sur les conséquences du libéralisme actuel, allant jusqu’à dénoncer la vacuité de la théorie du trickle down (ou « théorie du ruissellement »). Cette théorie supposerait que la croissance économique, favorisée par le libre marché, atteindrait l’objectif d’une meilleure équité à travers le « ruissellement » du capital issu de la consommation et de l’investissement des riches vers les plus pauvres. S’il ne rompt pas réellement avec les discours traditionnels de l’Église (Pie XI dénonçait déjà en 1931 « la dictature des marchés financiers », il aura étonnamment fallu attendre la fin de l’année pour que s’élèvent les premières accusations de la part d’éminents ultra-conservateurs nord-américains, à l’instar de Rush Limbaugh, animateur radio méthodiste réputé outre-Atlantique. Ce dernier aurait qualifié de « marxisme pur » un texte publié par le pape (l’exhortation apostolique « Evangelii Gaudium » ) fin novembre, et qui critiquait vertement la dictature d’un marché « implacable » et la « culture du déchet ». Jonathon Moseley, membre du Tea Party, a lui précisé que « Jésus était un capitaliste prêchant la responsabilité personnelle, pas un socialiste ».
« Une théologie du Peuple »
Le pape François a ainsi dû se défendre de ces « accusations » devant le journal italien La Stampa le 15 décembre, confiant cependant sa proximité avec des catholiques marxistes qu’il a qualifiés de « gens très bien », mais confirmant l’idée selon laquelle pour lui, cette théorie « était erronée », lui préférant l’invocation d’une « théologie du Peuple ». Se défendant ainsi de vouloir apporter une quelconque analyse économique technique ou de l’ordre de l’expertise, il a reçu le soutien de certains représentants de l’Eglise : ainsi, l’évêque David L. Ricken, au cours de la conférence des évêques des Etats-Unis, pourtant réputée très conservatrice, a au contraire salué les propos du pape, le qualifiant » d’exemple vivant de la nouvelle évangélisation . Au sein de l’épiscopat français, Mgr Hippolyte Simon, archevêque de Clermont, a qualifié François de » fidèle à la doctrine sociale la plus classique de l’Eglise, à savoir que le marché ne peut pas suffire à prendre en charge le bien commun: l’Etat doit participer à cette tâche « .
« Le catholicisme avait bien été la première Internationale de l’Histoire »
Ces relents de maccarthysme montrent ainsi comment les voix dominantes entendent représenter un monde des idées manichéen, et de fait insoluble. Le pape s’est expliqué, selon lui : « Les exclus ne sont pas des “exploités”, mais sont bien considérés comme des déchets, des restes », écrivait-il ainsi dans son exhortation. Visant certes une société qui prône le consumérisme, et pouvant ainsi s’apparenter au fétichisme de la marchandise décrit par Marx, lpour le pape François la collusion entre l’Eglise et le politique doit se faire à travers le peuple et en cela rien d’inquiétant, a priori. Mais l’accuser de marxisme reviendrait ici à instrumentaliser un discours qui pour certains membres membres de l’Église, à l’instar de Jean-Yves Naudet (professeur d’économie à l’université d’Aix-Marseille et président de l’Association des économistes catholiques), ne se détache pas de la position traditionnelle, mais complexe, de l’Eglise.
En effet, le souverain pontife en appelle directement à la doctrine sociale de cette dernière, qui reconnaît pourtant bien la propriété privée comme « l’une des conditions des libertés civiles », devant être équitablement accessible à tous, mais qui resterait cependant subordonnée à l’usage commun et à la destination universelle des biens, comme l’avait rappelé l’encyclique Laborem Exercens de Jean-Paul II en 1981. Ce dernier écrira pourtant plus tard, en 1987, dans son encyclique Solicitudo rei socialis, que l’Eglise « adopte une attitude critique vis-à-vis du capitalisme libéral et du collectivisme marxiste, deux conceptions du développement imparfaites et ayant besoin d’être radicalement corrigées ». Position donc ambigüe et qui n’a d’ailleurs peut-être pas à manifester de partialité idéologique pure et simple. Car au fond, ce débat n’a certainement pas lieu d’être, le coeur du discours du pape ne se situant pas sur quelque terrain idéologique ou économique, mais bien social, et, dans un sens, politique. Si les positions de l’Église s’interprètent, elles peuvent aussi être écoutées. Et cela me rappelle néanmoins un de mes anciens enseignants, qui nous avait affirmé qu’après tout, « le catholicisme avait bien été la première Internationale de l’Histoire ». A méditer ?
 Déjà le 26 avril 2011, le cannabis avait été dépénalisé en Uruguay: il pouvait être cultivé en petites quantités pour usage personnel. La loi en interdisait cependant le trafic, le distribution et la production. C’est en juin 2012 que le gouvernement de Mujica a annoncé un projet de légalisation de la vente de cannabis contrôlée par l’Etat, afin de combattre les crimes liés aux trafics de drogues et les problèmes d’enjeux sanitaires dérivant de l’usage de stupéfiants. A l’époque, il s’agissait d’un projet de 15 mesures dont le principal objectif était de lutter contre la hausse de l’insécurité. Ces mesures prévoyaient notamment des peines plus sévères pour les cas de corruption policière ou de trafic de pâte de cocaïne, ainsi que pour les mineurs délinquants. Il était également question de rendre les services de police plus efficaces.
Déjà le 26 avril 2011, le cannabis avait été dépénalisé en Uruguay: il pouvait être cultivé en petites quantités pour usage personnel. La loi en interdisait cependant le trafic, le distribution et la production. C’est en juin 2012 que le gouvernement de Mujica a annoncé un projet de légalisation de la vente de cannabis contrôlée par l’Etat, afin de combattre les crimes liés aux trafics de drogues et les problèmes d’enjeux sanitaires dérivant de l’usage de stupéfiants. A l’époque, il s’agissait d’un projet de 15 mesures dont le principal objectif était de lutter contre la hausse de l’insécurité. Ces mesures prévoyaient notamment des peines plus sévères pour les cas de corruption policière ou de trafic de pâte de cocaïne, ainsi que pour les mineurs délinquants. Il était également question de rendre les services de police plus efficaces.
Depuis l’accession au pouvoir du Frente Amplio au pouvoir en 2009, avec à sa tête Mujica, l’Uruguay représente un Etat précurseur en matière de politiques publiques progressistes. En effet, avec la dépénalisation de l’avortement et du mariage gay, le pays avait déjà fait preuve d’un certain dynamisme législatif, en phase avec les moeurs de sa société. Désormais, le gouvernement s’attaque à un enjeu de plus grande ampleur, car il serait le premier pays au monde à légaliser la consommation et la production de cannabis. Ainsi, selon la loi, «L’Etat assumera le contrôle de l’importation, de l’exportation, de la plantation, de la culture, de la récolte, de la production, de l’acquisition, du stockage, de la commercialisation et de la distribution du cannabis et de ses dérivés». C’est le 31 Juillet 2013 que la chambre des Députés uruguayenne a adopté une loi visant à la légalisation et à la régulation de la consommation et de la vente de cannabis, par 50 voix contre 46. Dans l’attente de sa ratification par le Sénat, (où le Frente Amplio est majoritaire), qui devrait être réalisée le 10 décembre, les pouvoirs publics porteurs du projet ont commencé à organiser la mise en place de cette politique de santé publique et de lutte contre la criminalité liée aux trafics de stupéfiants. Seul un référendum à l’initiative de l’opposition pourrait encore bloquer le processus législatif. La loi fut votée en aval du décret-loi nº 14.294 datant du 31 octobre 1974, qui autorisait l’usage du cannabis mais rejetait la production et la commercialisation dans la clandestinité.
La commercialisation, selon le Secrétaire Général du Conseil national des drogues (JND) uruguayen, Julio Calzada, devrait débuter mi-2014. Sur un total de trois millions d’habitants, près de 120 000 personnes consommeraient du cannabis au moins une fois par an, selon l’Office National des drogues, soit 18 000 par jour. Un uruguayen sur cinq aurait déjà fumé (Hommes: 25,2% Femmes: 15,2%), et concentration à 26,9% à Montevideo (Intérieur: 11%).
L’Uruguay possède des avantages structurels et contextuels dans la mise en place de cette loi: c’est un petit pays, avec peu d’habitants, et qui, comme l’a souligné Julio Calzada, possède une géographie peu propice au narco trafic: pas de montagnes ou de jungle. De plus, le pays est peu touché par la grande violence liée au narcotrafic: 85 crimes spécifiques au milieu en 2012. La mise en place de ce projet est ancrée dans un contexte latino-américain de rejet progressif des politiques prohibitionnistes depuis quelques années, et qui commence également à s’installer en Amérique du Nord. En effet, il y a une quarantaine d’années, en 1971, le président US Nixon avait déclaré la drogue «ennemi numéro 1 des USA» et avait lancé une guerre contre les cartels en Amérique Latine (War on drugs). Ainsi, la majorité des pays du sous-continent ont calqué leurs politiques en matière de stupéfiants sur les USA, c’est à dire en instaurant des législations prohibitionnistes visant à criminaliser aussi bien les producteurs et les trafiquants que les consommateurs. Et selon certains analystes, la largesse de ce spectre criminel rendrait caduque les outils de répression mis en place par les Etats, notamment à travers de l’autonomisation des grandes organisations criminelles et à une régionalisation du trafic.
Ainsi, ces derniers temps, des voix se sont élevées en Amérique latine pour réclamer un changement des mentalités et des législations en faveur de la légalisation. L’objectif serait de trouver une solution alternative à la guerre menée contre le narcotrafic, qui rien qu’au Mexique, a entraîné la mort de plus de 70 000 personnes depuis décembre 2006. Le principal obstacle à de tels changements reste les Etats-Unis, même si lors du dernier Sommet des Amériques, qui a eu lieu en avril 2012 à Carthagène (Colombie), le président Barack Obama a estimé qu’il était “parfaitement légitime d’aborder le sujet”.
A travers cette loi, l’Etat uruguayen se réapproprie ainsi un marché informel jusqu’alors contrôlé par des groupes illégaux et considérés comme dangereux pour la cohésion sociale. Ce marché touche ainsi de nombreux pans de la société, tels que l’économie, la santé et les institutions politiques, à travers ses impacts en termes de financement du crime organisé, de la traite humaine, de la vente d’armes ou du blanchiment d’argent. Le but annoncé par le gouvernement fut donc d’abord de couper les consommateurs des réseaux de trafiquants afin de concentrer la répression sur ces derniers.
L’Uruguay, Etat fort et de petite superficie, représentera ainsi à partir de 2014 le premier laboratoire politique au monde en termes de légalisation du cannabis. Dès lors, les questions relatives au contexte national qui se posent sont: `
-La stratégie de dépénalisation et de légalisation permet-elle de réduire la violence et la délinquance ?
-Y aura t-il une amélioration la santé publique en matière de prévention, de prise en charge, de traitement et d’aide à la réinsertion des patients ?
-L’Etat saura t-il gérer économiquement cette nouvelle manne fiscale ?
-Pourra t-il éviter l’émergence ou la recrudescence d’un marché noir ?
La stratégie du gouvernement est basée sur le principe de «Réduction des risques et des dommages». C’est une approche basée sur la défense de l’usager et non sur sa répression, sa criminalisation et sa «pathologisation» depuis «le haut» (les autorités publiques). L’accent est mis sur l’accès à des services de proximité, et l’on recherche ainsi une alternative en termes de santé publique, face à ce qui est considéré comme l’échec des modèles «moralistes/criminalisants».
Plusieurs objets sont concernés par la promulgation de cette loi, qui représenterait un changement en termes de politiques publiques au niveau national, mais qui s’inscrit aussi dans un processus commun à tout le continent latino-américain en termes de régulation du marché de la drogue par les Etats. Les droits du citoyen, tout d’abord: l’Etat cherche par cette loi à articuler et à mettre en cohérence le droit des citoyens à disposer «du plus haut niveau de santé possible, du droit à profiter librement des espaces publics dans des conditions sûres, (…) et à la prévention, au traitement et à la réinsertion sociale en cas de maladie». Jusqu’ici, la loi ne criminalisait pas la consommation de cannabis, mais en revanche sanctionnait les formes d’accès à la substance. On parlait de «tolérance» à l’égard des consommateurs. Ils ne risquaient pas de poursuites pénales mais juste d’être accusés de délit et de devoir payer une amende. En revanche, ce qui était poursuivi par la loi était le circuit en amont (production et vente). L’idée principale ici est de faire coexister le droit des citoyens à la santé et à la sécurité et le cadre légal du marché du cannabis. On veut avant tout protéger le citoyen des conséquences du narcotrafic et de la délinquance en matière de vente illégale de stupéfiants.
Artículo 4 º. « La presente ley tiene por objeto proteger a los habitantes del país de los riesgos que implica el vínculo con el comercio ilegal y el narcotráfico buscando, mediante la intervención del Estado, atacar las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas del uso problemático de sustancias psicoactivas, así como reducir la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado. »
Puis, il y a un enjeu en termes de santé publique : “Nous pensons que l’interdiction de certaines drogues pose plus de problèmes au sein de la société que la substance proprement dite”, a déclaré Eleuterio Fernández Huidobro, ministre uruguayen de la Défense, lors d’une conférence de presse. L’Uruguay a déjà fait preuve de politiques efficaces en termes de santé publique, notamment en ce qui concerne le tabac et l’alcool. Cela lui a d’ailleurs valu de devoir s’opposer au géant Philip Morris en 2011. Cela se traduira ici par la mise en place de politiques d’éducation et de prévention au sein des institutions scolaires et universitaires, notamment. Dans les villes de plus de 10 000 habitants, seront instaurés des dispositifs d’information, de conseil, de diagnostic, d’attention, de réinsertion et de traitement des patients et des usagers.
De plus, l’Etat cherche à couper et paralyser les activités des narcotrafiquants, en décidant de vendre 1 dollar le gramme de cannabis contre 1,5 $ sur le marché noir. Enfin, il bénéficiera de l’obtention de rentrée de fonds (fuite estimée à environ 30 millions de dollars par an) à travers un système de taxation sur le marché régulé.
Les politiques publiques en matière de santé, et plus particulièrement en ce qui concerne les drogues, sont transversales et articulent de nombreux enjeux auquel l’Etat doit faire face. En effet, outre les problèmes de santé publique pour les citoyens, le trafic et la consommation illégale de stupéfiants touche les secteurs de l’économie, de la sécurité, mais également des institutions en termes de dérives corruptrices au sein de la classe politique.
Les outils mis en oeuvre sont multiples, pour mener à bien cette politique: le projet définit un système de permis et un mécanisme de régulation. Il créé l’IRCCA (Instituto de Regulación y Control del Cannabis), intégré par le Ministère de Santé Publique, celui de l’Elevage, de l’Agriculture et de la Pêche, et du Développement Social. La Junta Nacional de Drogas également. Cet organisme est chargé de la régulation et génère des communiqués et des publications pour une évaluation constante des impacts de la politique.
Le système de permis:
Afin de contrôler le marché, seront octroyés trois types de permis:
-Autoculture: six plants maximum et 480 g par an
-Sites de vente autorisés, comme les pharmacies (40g max par personne et par mois)
-Clubs de cannabis, où l’on peut cultiver la substance en quantité proportionnelle au nombre de membres (comprenant un minium de 15 et un maximum de 45 personnes et pourront détenir jusqu’à 99 plants)
Enfin, le système de régulation (réduire les risques et les dommages) permettra le respect de la loi:
-Interdiction de commercialisation aux moins de 18 ans
-Peines pour ceux qui conduisent sous effet de la drogue
-Sanctions pour les cultures illégales (sans autorisation)
-Restriction et législation en ce qui concerne les espaces publics et pas de pub
Les grands axes de la réforme sont donc de contrôler l’offre, de réduire la demande et plus globalement de résoudre les problèmes qui dérivent du marché de la drogue (blanchiment d’argent). La culture ne sera permise qu’aux ressortissants uruguayens ou aux étrangers résidents légaux. Mujica a présenté cette mesure comme une forme « d’expérimentation ». Il a aussi affirmé que si plus de 60% des citoyens s’opposaient à la mesure elle serait annulée. Or, un récent sondage de l’institut CIFRA montre que près de 63% de la population s’oppose à la loi. Cela pose un problème démocratique, mais surtout en ce qui concerne le changement de politique. Ici, comme les lois sur l’avortement et le mariage gay, les institutions prennent en compte la réalité sociale pour y adapter la loi. La loi s’adapte aux moeurs. Ici, la loi prend en compte une réalité: la présence croissante du cannabis dans les pratiques des citoyens, même si une majorité serait contre. Il s’agit donc d’encadrer un fait social jusqu’alors comme délictuel par l’Etat, voire même à le rendre visible et institutionnalisé. Le changement par les politiques publiques soulève ici la question du «dialogue» et de l’interaction entre les pouvoirs publics (la loi) et le reste de la société (les citoyens). On peut penser à l’année 1981 en France, lorsque le Président d’alors, François Mitterrand, a aboli la peine de mort, alors que la majorité des français était encore favorable à cette mesure. Aujourd’hui, personne (ou presque) n’irait la remettre en cause. On peut donc envisager un pouvoir transformateur de la loi dans les moeurs: la routinisation et l’acceptation du changement institutionnel et politique dans les pratiques quotidiennes peuvent être attribuées à plusieurs facteurs: légitimité du chef de l’Etat, ouverture politique à l’opposition, implication politique des citoyens…L’Etat uruguayen serait-il plus progressiste que ses citoyens, en «avance» sur l’opinion ?
Selon Jean Rivelois, sociologue et chercheur à l’IRD, l’argument idéologique soutient aussi que c’est contre les USA que cette politique s’inscrit, comme un mauvais coup joué contre l’ennemi impérialiste, en somme. Reste à voir si la loi se traduira concrètement dans les faits par une diminution de la criminalité et une amélioration de la santé publique. Quoiqu’il en soit, c’est tout ce que nous souhaitons à l’Uruguay.

Touche pas à mon pote, touche pas à mon poste, touche pas à ma pute, touche-moi pas j’suis en rut. Touche pas mon jardin, touche pas ma bagnole, touche pas mon gamin et encore moins son école. Touche pas à ton corps, touche pas mon diplôme, touche pas notre accord, touche pas aux fantômes. Touche pas à la misère, t’en approche pas non plus. Touche pas mes droits, mon salaire, touche pas mon Ministère. Touche pas mon cul ni mon culte, en Décembre touche pas à ma neige ni à mes privilèges. Touche pas à ma route, touche pas au budget, touche pas ce que j’écoute, regarde pas tous ces gays. Touche pas à mes prix, touche pas au budget, touche pas au Grisbi ! Touche plutôt ta paie. Touche du doigt, touche du bois, touche là où ça fait mal, mais touche pas ce qu’est normal. Touche pas ma vitrine, touche pas j’te dis t’es fauché. Touche pas mon Club Med, ni mon dimanche sous le soleil, touche pas mon remède, car y’en a pour de l’oseille…
Normal…Normal qu’on ai tous plus qu’à se coucher. Ou à se toucher. Coulés.
Une fois n’est pas coutume, les médias français se sont engouffrés dans la brèche ouverte par le gouvernement lors de la faute de communication de Pierre Moscovici sur France Inter le 19 août, lorsqu’il a affirmé « comprendre le ras-le-bol fiscal » des Français. Un ras-le-bol, qui rappelons-le, partant d’un « ressenti » de la part du ministre de l’Economie et des Finances, s’est peu à peu métamorphosé en une réalité sociale clivante et fumeuse, relevant davantage d’une construction médiatique globale et consentie que de l’analyse solide dont les journalistes auraient besoin, à l’aune des municipales de 2014. En effet, les principaux chiens de garde du pays se sont empressés de reprendre et d’alimenter l’idée d’une fiscalité déraisonnable, qui orienterait toujours plus l’opinion publique vers son désamour déjà affirmé envers la majorité actuelle. Les journaux tels le Figaro, Libération, le Monde, ou encore Le Parisien, L’Express, Le Télégramme – participant, plume contre plume, à cette nouvelle fronde – ne s’avèrent être que l’illustration du recours à la facilité que représente l’entreprise des sondages en France : 86 % des Français, selon l’étude de l’Institut CSA-Nice Matin du 15 septembre, seraient « opposés » à la hausse des impôts (où 49 % des Français disent ressentir « tout à fait » un « ras-le-bol fiscal » et 35 % « plutôt »). Et cela a entre autres suffi à donner du grain à moudre aux fers de lance de la pensée dominante, de la démagogie, sans réelle pédagogie ni éclaircissement de l’information.
La réforme fiscale du gouvernement vise à récolter 10 milliards d’euros de recettes supplémentaires, c’est un fait. Or, entre 2000 et 2010 les baisses d’impôts mises en place par la droite s’étaient élevées à 120 milliards d’euros, et comme chacun sait, au bénéfice des Français les plus aisés et des entreprises. Le résultat de cet acte – aujourd’hui réclamé de la part de (presque) tous les fronts – avait été le sacrifice des recettes fiscales, des dépenses publiques, et en conséquence des services régaliens de base que sont une éducation ou une santé gratuite et de qualité. Ajoutons à cela, l’évasion et la fraude fiscales, qui se sont soldées à presque 80 milliards d’euros de pertes pour l’Etat provoquant une baisse de recettes fiscales et donc de dépenses publiques. Quant à ce que le gouvernement actuel initie au travers de l’augmentation de la part des prélèvements obligatoires serait, selon Guillaume Duval d’Alternatives économiques, une tentative de retour au niveau de 1999. Les mesures supplémentaires pour 2013 n’auraient ainsi eu que pour effet de ramener la fiscalité des revenus et du capital des ménages au niveau qui était le sien en 2000, avant la débauche des baisses d’impôts pour les plus riches et les entreprises.
L’illusion du « ras-le-bol fiscal » ne fait finalement que cacher le réel problème : l’injustice fiscale. Ne pourrait-on pas plutôt parler de ras-le-bol contre la fraude fiscale – dont l’insuffisance de lutte contre cette dernière a été récemment pointée par la Cour des comptes – plutôt que de « ras-le- bol fiscal » ? A trop jouer le jeu des crispations françaises, passe-temps favori des entrepreneurs de morale médiatiques, on en oublie la source, le bois dans lequel le bateau qui nous mène a été construit. Nous parlons ici des dépenses des ménages et de leur pouvoir d’achat, qui comme toujours pour les moins aisés, et disons-le clairement pour la classe ouvrière, seront davantage affectés que ce que ne font justement pas ressortir les journalistes. Quid des 135 milliards de TVA, taxe inique qui est payée majoritairement – car ils sont plus nombreux – par les « pauvres » et qui va augmenter cette année ou encore la précarité des jeunes qui sont sujets à des charges de logement de plus en plus élevées, à l’abaissement prévu du quotient familial ainsi qu’à la suppression de la réduction d’impôts pour les frais de scolarité ?
Au lieu de cela, on préfère plutôt s’engager dans une entreprise d’empathie feinte vis-à-vis de l’ensemble des Français qu’on réduit à leurs présupposés protagonistes : les « classes moyennes », terme incluant 80 % de la population – allant des ouvriers qualifiés aux cadres supérieurs – et ne visant qu’à effacer le « clivage de classe »
Voilà encore de la part des médias un accès de facilité qui relève cette fois-ci du manque total de professionnalisme, et bien plus grave encore, du mépris pour ceux qui vont réellement payer, ou qui vont finalement échapper au consentement de l’impôt, ces derniers étant bien souvent les plus aisés, en témoignent les cadeaux accordés dans le domaine de l’immobilier. Et si la classe capitaliste s’indigne facilement des impôts versés à l’Etat, aucune voix ne semble s’élever contre la hausse du gaz qui a augmenté de 80 % entre 2004 et fin 2012 ou encore l’électricité dont le prix du kilowatt a augmenté de 7,5 % en un an. Comme le note à juste titre Hubert Huertas dans son article « Ras-le-bol fiscal : l’overdose » : « A écouter le discours dominant (…) il est plus supportable de régler sa note de gaz que de payer un professeur ». C’est ce même discours qui montre du doigt la France pour l’ensemble de ses taxes qui représentait 42,9 % de la richesse nationale en 2010 – moins que le Danemark (47,6 %) mais bien plus que le Royaume-Uni (34,9 %).
Discours, qui semble oublier que les Français profitent, ont profité et profiteront de services rendus par une action publique bien plus développée que chez son voisin britannique : si les Anglais paient moins d’impôts, il ont beaucoup plus de frais personnels à couvrir par rapport à l’école ou encore aux retraites.
Encore un autre volet oublié, c’est celui des élections municipales du mois de mars 2014. Car on assiste bien plus à un débat entièrement politisé qu’à une véritable analyse de la situation économique, fiscale et budgétaire qui s’annonce pour la France, et qui bien évidemment s’inscrit directement dans le contexte électoral des élections municipales. En effet, au sein de l’opposition, les candidats UMP n’ont pas tardé à réagir en instrumentalisant le débat national sur le « trop plein-d’impôts » en un débat local en en faisant un axe de sa campagne pour les municipales. Pourtant, comme le rappelle Hervé Gattegno sur RMC, l’UMP semble sciemment oublier que sur ces 4 dernières années, s’il y a eu 60 milliards d’augmentations d’impôts tous confondus, plus de la moitié d’entre eux – soit 33 milliards – ont été décidés sous Nicolas Sarkozy et François Fillon qui aujourd’hui, ne cesse de décrier l’ « assommoir fiscal » à propos de la politique actuelle. C’est donc en réduisant le débat sur la politique économique à un simple « poujadisme fiscal » que l’UMP a décidé de discréditer la politique nationale tout en flattant le contribuable.
L’UMP a ainsi lancé mercredi 18 septembre une campagne qui prévoit la diffusion de plus d’un million et demi de tracts et d’affiches sur le thème « 50 milliards d’impôts : trop c’est trop! », « Libérons les Français » ou encore « Trop d’impôt tue l’emploi ». Selon ces tracts, les candidats UMP aux municipales « s’engagent à ne pas augmenter les impôts », voire à les baisser. C’est notamment le cas à Paris où Nathalie Kosciusko-Morizet (UMP) a brandi la diminution fiscale en étendard – quelques semaines avant que les contribuables ne reçoivent la facture de leur taxe d’habitation – en annonçant un « allègement de la pression fiscale » et une baisse du budget de la ville de Paris de 1 milliard d’euros (sur un total de 8 milliards) et sans préciser où se feront les coupes budgétaires. En face, la candidate du Parti socialiste, Anne Hidalgo, se dit « soucieuse du pouvoir d’achat des Parisiens » et estime que le « gouvernement est allé trop loin dans l’augmentation des impôts » mais s’oppose aux dires de NKM sur la supposée augmentation de 40 % des impôts parisiens sous Delanöe. Si la candidate PS concède deux hausses de 8 % et 9 % des impôts locaux, et la mise en place d’une taxe de 3 %., elle rétorque d’un ton moqueur : « Il suffit de savoir compter : 9 + 8 ce sont les deux augmentations qu’il y a eu en 2009 et en 2010, plus 3 % la création d’une taxe départementale, ça ne fait pas 40 % ». Cette rixe fiscale montre que le gouvernement social-libéral n’a finalement abouti qu’à une chose : la création d’un sentiment de défiance vis-à-vis de l’impôt qu’il essaie maintenant de désamorcer.
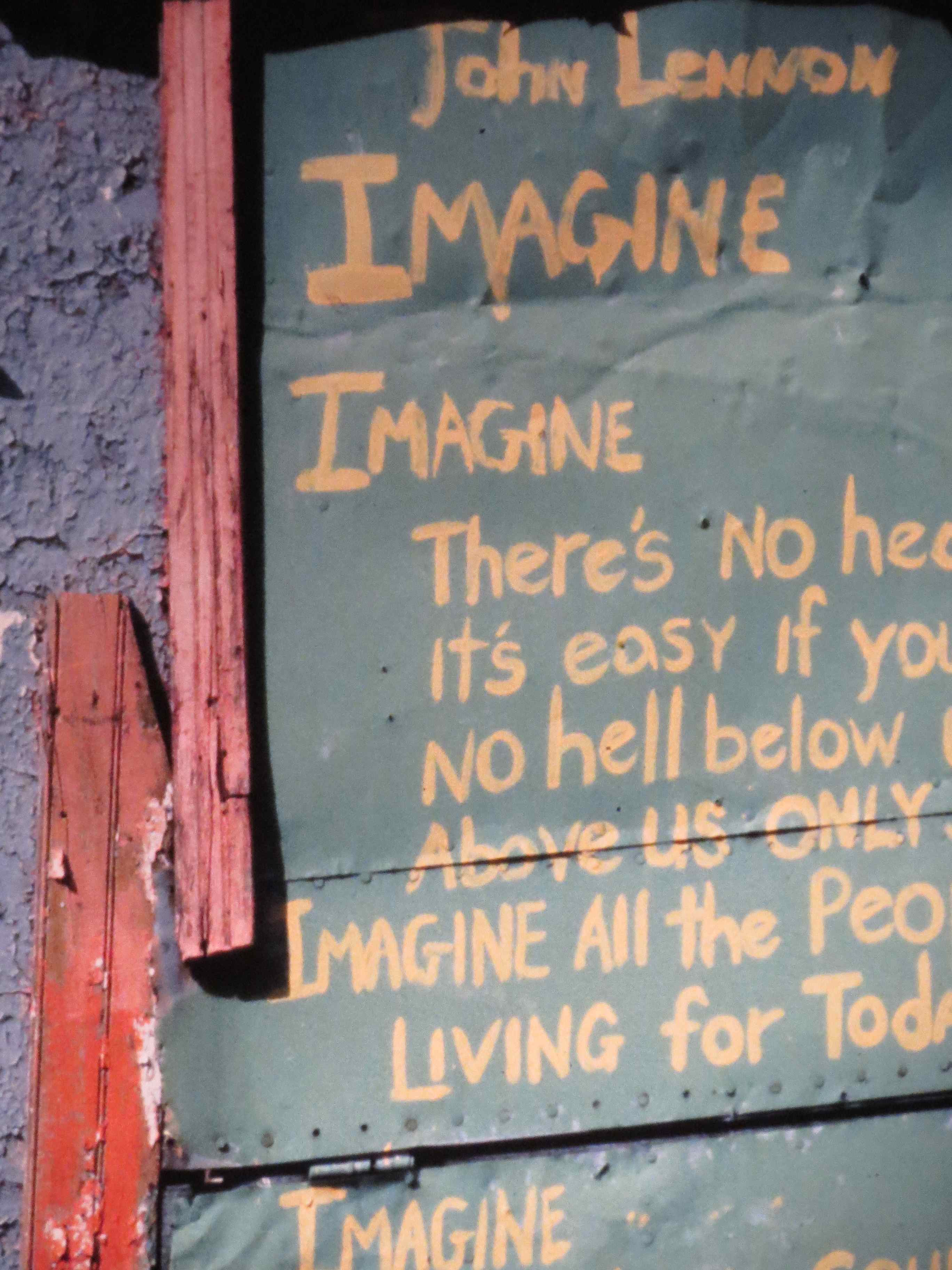 La Pecha Kucha à Montevideo, Uruguay.
La Pecha Kucha à Montevideo, Uruguay.
En France, c’est en 2013 que le Palais de Tokyo a organisé, à Paris, sa première soirée Pecha Kucha. Je suis allée à cette soirée plutôt intriguée, et en toute honnêteté, en essayant de faire abstraction du hall d’entrée où se tenaient paresseusement des standes tenus par les sponsors qui n’offraient rien, (si ce n’est en l’échange de notre participation à un jeu mystérieux et inaccessible aux vues de la queue qui attendait, permettant de gagner un coca, pardon, un pepsi), j’ai apprécié ce moment original et intriguant. Certes, cela m’a beaucoup fait pensé à nos mythiques exposés à Sciences Pipo où l’on doit parler en un espace de temps contraint de choses que l’on ne connait qu’à moitié, ou pas du tout. Mais finalement, rien à voir. Les orateurs étaient simples, s’exprimaient avec maladresse, humour, clarté, intelligence, et surtout, avec conviction. Proposant, à leur manière, des idées, des projets, des choses abouties ou non. Mais l’une des choses les plus pertinentes qui m’est restée, et qui a d’ailleurs clôturé la soirée, c’est cette remarque d’une femmde de Rosario, Santa Fe, Argentine: « Et vous, qu’est ce que vous avez à proposer ? »
Ce dimanche 23 juin, les gens sont allés voter, ici. Les citoyens ont été appelés à se prononcer sur l’organisation d’un référendum visant la toute récente loi de dépénalisation de l’avortement dans les trois premiers mois de la grossesse, adoptée de justesse en octobre dernier. Ce sont ainsi des groupes indépendants, du parti de droite «Colorado» ainsi que du parti centriste «National», qui tentent l’annulation de cette décision politique progressiste, dans un pays où il est inutile de rappeler que la tradition religieuse catholique joue encore un rôle prépondérant dans les moeurs.
Le principe était clair: si 25% des électeurs uruguayens se manifestaient aux urnes ce dimanche, un délai de 120 jours aurait été accordé aux détracteurs afin de déterminer la date d’un référendum sur le maintien ou l’abrogation de la loi sur les IVG.
Hormis Cuba, la Guyane et les districts de Mexico et de Porto Rico, aucun pays n’autorise les interruptions volontaires de grossesse en Amérique Latine, excepté lorsque celle-ci est la conséquence d’un viol, par exemple. L’Uruguay, en votant cette loi en octobre, avait ainsi fait un pas en avant notable sur le plan social, mais également sanitaire.
Les résultats furent nets et sans bavures: ils ne furent que 8% à se déplacer pour manifester leur désir d’organiser un plébiscite contre la loi. Si l’on peut se réjouir de ces résultats, qui furent reconnus comme une défaite cuisante, voire humiliantes pour les «pros-vie», cela m’a immédiatement amenée à m’interroger sur la pertinence de ces modes de démocratie directe que nous ne connaissons pas en France. Peut-on se permettre de se demander ce qu’il en aurait été d’un système où les anti-mariage pour tous auraient eu la possibilité d’organiser un scrutin d’initiative populaire afin de retoquer la loi (péniblement) votée il y a peu à l’Assemblée Nationale ?
L’ex-Président uruguayen Vazquez a évoqué les résultats de cet appel au vote en refusant le manichéisme, et a parlé d’une «citoyenneté convaincue que le pays doit sans cesse s’améliorer», et où «il n’y a ni bons ni mauvais électeurs». Il aurait même été applaudi par l’opposition. Ceci me fait juste penser que les espaces politiques sont nécessaires afin de contenir les frustrations ou les ressentis de l’opinion. La possibilité d’un échappatoire, par les urnes, même s’il ne mène à rien ou qu’il est initié par des idées conservatrices et rétrogrades, peut être une garantie d’équilibre social, où chacun, par l’effort d’un élan commun (ici, initier un scrutin, récolter des voix), peut faire entendre sa voix, sans attendre que les dirigeants la lui donnent. Je ne doute pas que tout ce qui touche à la démocratie directe doit être traité avec prudence. Je suppose simplement que l’idée de cristalliser des idées intolérantes ou «réfractaires au progrès» dans un bulletin de vote les aurait peut-être, qui sait avortées dans l’oeuf un peu plus rapidement que les innombrables débordements dont la Manif’ pour tous nous a fait le spectacle ces derniers mois.
Les diagnostics s’imposent. A regarder d’un peu plus près, on a l’impression qu’il y a un truc, quelque part. Quelque chose qui s’est échappé de la machine où qui s’y est méchamment incrusté.
Les rues sont pleines. Pleines de gens, de déçus, d’affamés, de dépravés (ben oui, faut bien l’avouer, on vit dans un monde de FOUS), de pétasses, de précaires, de précoces, de pas finis, de pas-commencés, aussi. Nous sommes l’ébauche de nous-même. On nous attend au tournant. On n’arrive pas à se l’avouer, mais les faits sont là. A croire que la violence est devenue le nouveau critère de participation sociale.
On assiste depuis quelques mois à des mouvements citoyens de grande ampleur, au Brésil, en Turquie, en Egypte, pour ne citer que ces pays. Les citoyens occupent les espaces publics, pour réclamer un dû bien trop souvent oublié: un peu plus d’ouverture politique, un peu moins de gaspillage des fonds publics, non, trois fois rien, la conservation des lieux symboliques aux yeux des gens, comme un parc. Cela naît d’un petit rien: un ticket de bus, quelques tweets, des photos, des relais, et puis la mèche est allumée. Et souvent, comme on s’en rend bien compte, car c’est toujours davantage le cas, le reste de la population, ou ceux qui en ont les moyens, se joignent au mouvement et construisent la mobilisation globale, la portent et la nourrissent, dans un élan commun.
Ce qui m’a frappé ces trois derniers mois, et j’en reviens toujours à une comparaison entre mon propre pays et ceux que je viens d’évoquer, si pauvre soit ce parallèle, c’est l’omniprésence de la violence, et son expression bien spécifique à chacun des cas. Surtout en France, où dernièrement, on ne parle pas d’un mouvement social, mais d’une multitude de mobilisations étrangères les unes aux autres. La participation sociale a t-elle le monopole de l’individualisme politique ? Je regarde vers mon pays, et je vois des fascistes contre des anti-fascistes, des anti-mariage pour tous contre des pro, des syndicats enseignants contre le Ministère de l’Education, des patrons contre des employés, des chats contre des chiens, en somme. Les causes qu’ils défendent sont toutes légitimes. Je ne reviens pas là-dessus. Elles sont propres à chaque groupe, à chaque identité. Une chance qu’elles puissent d’ailleurs s’exprimer librement. Mais juste une remarque: à quand aurons-nous en France un mouvement social d’ampleur, qui ne se traduise pas par une violence crue utilisée les uns contre les autres ? Sachons reconnaître l’ennemi commun. Ou bien, mieux encore, sachons déjà nous reconnaître comme de potentiels alliés, tous, comme un peuple qui veut avancer, créer pour chacun des conditions de vie moins pénibles, des opportunités d’avancer. Sans même aller jusqu’aux résultats concrets, ayons déjà conscience de nous-mêmes, en tant que peuple. Ouh, le vilain mot. Et pourtant, et pourtant, elle est peut-être là, l’idée.
 Faire et défaire le réel. Nous obliger, chaque jour, à le regarder avec ces lunettes, non non, pas les nôtres, celles qu’ils nous imposent, ce monde qu’ils exposent, celui qui n’est pas le nôtre, qui n’est celui de personne, et qui nous font bien vite comprendre que du monde, il y en a partout, mais qu’il n’y a jamais personne nulle part.
Faire et défaire le réel. Nous obliger, chaque jour, à le regarder avec ces lunettes, non non, pas les nôtres, celles qu’ils nous imposent, ce monde qu’ils exposent, celui qui n’est pas le nôtre, qui n’est celui de personne, et qui nous font bien vite comprendre que du monde, il y en a partout, mais qu’il n’y a jamais personne nulle part.
Non, personne ou si peu, pour nous aider à défaire ces lacets, ceux des faits, ces faits dont bien vite s’emmêler avec nous conduit à nous lasser. Oui lassés, d’écouter, de voir ou de lire, ce que l’époque a de pire et de meilleur, ces mots qui nous entourent, qui veulent nous expliquer les couloirs de la politique, de l’économie, de la société, des réseaux, de l’environnement, des grandes marques ou de l’histoire.
Les mots sont, comme l’entendait Yves Bonnefoy, des leurres, ils affadissent la matière et le sens. Ils sont aussi un terrible instrument de pouvoir qui aujourd’hui, mêlés dans les galaxies de la communication et de l’information, tendent aussi à s’affaiblir eux-mêmes, souvent. Ils perdent de leur richesse symbolique pour s’offrir aux pulsions individualistes ou à celles des foules. Ils manipulent, trompent, font s’égarer les garants supposés de la démocratie: celle qui nous dit tout, qui nous donne à tous cette formidable sensation d’être à la fois libres et égaux devant le sens des choses. Liberté, Egalité chéries. Les accès sont multiples, faciles, attrayants. Pensées pré-mâchées pour des canines peu assurées. On nous dit tout, mais on ne sait rien.
Alors, quelle est l’issue ? Redonner du sens aux mots ? Ils en ont déjà, et même parfois trop. Ce sens existe, il est juste fardé de simulâcres, il reste le même, sauf qu’à la manière d’un ingrédient mal blanchi, il en devient indigeste. Les mots sont à tous et pour tout. A chacun de choisir sa méthode: leur exiger la rigueur, revenir à leur essence première, garder le cap face à l’anarchie des discours. Ou bien se les réapproprier, créer nos contre-sens. Un autre monde réel.
Image: Gerard Antigny