Veilleuse
Le bateau est immense, et toi à son bord tu traverses la mer
la mer partout présente, des vagues noires, invisibles. Tu les entends justes qui crient / qui hurlent / qui chuchotent / qui murmurent /
qui râlent / qui chantent / appellent les indécis
qui chuchotent qui murmurent
qui feulent.
Et puis, dernières touches avant toi sur ce décor de vide : la nuit dans le ciel, et la nuit tout autour, mêlée à la mer.
Peut-être es-tu là simplement par hasard. Embauché rapidement à la dernière escale, pour remplacer Georges…
le vieux Georges…
le vieux Georges qui, hier au matin, a déserté la mer…
…et toi, tu te tiens là, seul, accoudé à la nuit sans rien en savoir
…tu te tiens là, quand soudain
surgis d’on ne sait où,
deux grands yeux sombres
tournés vers toi.
(et ce n’était pas, ces yeux, un refuge éternel où le monde, enfin, devenait immobile.
C’était le monde par vagues, le monde remuant de partout – et aucune terre, aucune pause, aucun abri qui tienne face à cette tourmente qui refuse de finir – mais qu’importe
qu’importe,
car dans ces yeux tu pouvais l’apprendre – cette magie – toi et le monde (ton souffle, le sien) – toi et ces vagues incessantes (sa peau, la tienne) – cette magie de l’avec, toi, tu pouvais l’apprendre,
dans ses yeux – deux grands yeux sombres, et à ses lèvres, aussi)
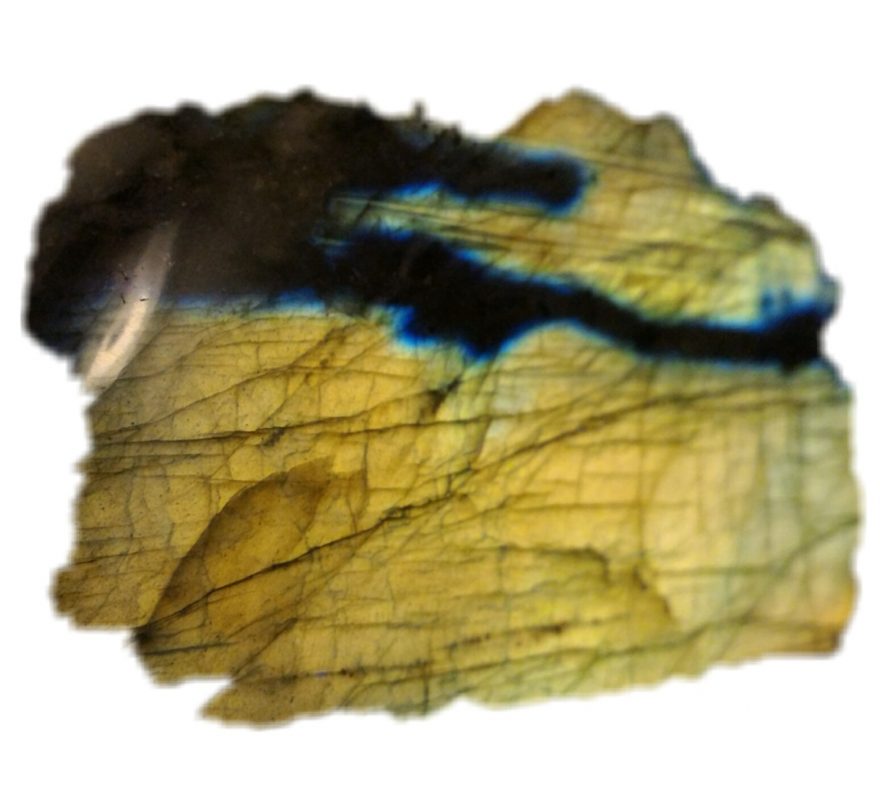
− Je ne dis pas que j’aurais préféré mourir, hein.
(c’est toujours le même bateau)
− Tu voudrais juste comprendre.
− Voilà. Au moins un peu.
(c’est le lendemain soir)
− Comprendre pourquoi.
− Voilà.
(une grande salle éclairée, avec bar, et banquettes,
et petites tables, et tabourets, le tout riveté au sol – avec la mer, on ne sait jamais)
− C’est vrai que c’est dingue.
− …
(un instant bref, fait de silence. Dehors, c’est la nuit, de nouveau)
− Et Dieu, tu y crois ?
(cette question, tu la poses au grand type, qui est là devant toi.
Brian Finnigan, il s’appelle. L’équipage l’a sauvé, juste ce matin à 5h47. Plus vraiment le choix, te répond-il)
− J’imagine qu’il faut bien que je croie en un truc, à présent. Mais je ne sais pas vraiment quoi, remarque. Pas encore.
− Oui, oui, je comprends : trop tôt pour choisir.
− Oui, voilà, trop tôt. C’est ça.
(il les murmure encore un peu, ces deux mots – trop tôt – deux
mots légers, frontière de l’inaudible, et qui s’en vont dériver,
par là-bas, quelque part dans le silence qui à cet instant
retombe. Toi, tu l’as vu de loin, ce sauvetage. Tu étais presque
là ce matin, à 5h47, quand ils le remontèrent.
Lui, Brian Finnigan.
Lui qui pendant dix-sept jours avait séduit la mort, la faisant patienter – non non, pas encore, pas maintenant s’il te. plaît, attends encore un peu… –
tout ça pour finalement, et après dix-sept jours – dix-sept jours,
c’est-à-dire, disons-le, quasiment dix-huit –
lui, donc, qui fit patienter la mort, pendant presque dix-huit jours, avant de
(finalement)
finalement se barrer sans rien dire,
s’enfuir comme un voleur sur le premier paquebot venu croiser sa
route,
c’est-à-dire celui-ci – celui où tu te trouves – ce soir – à boire tranquillement un whisky avec lui.)
(– Quel salaud ! pensa la mort.
Et que n’aurait-on pas dit, si cet homme était une femme !)
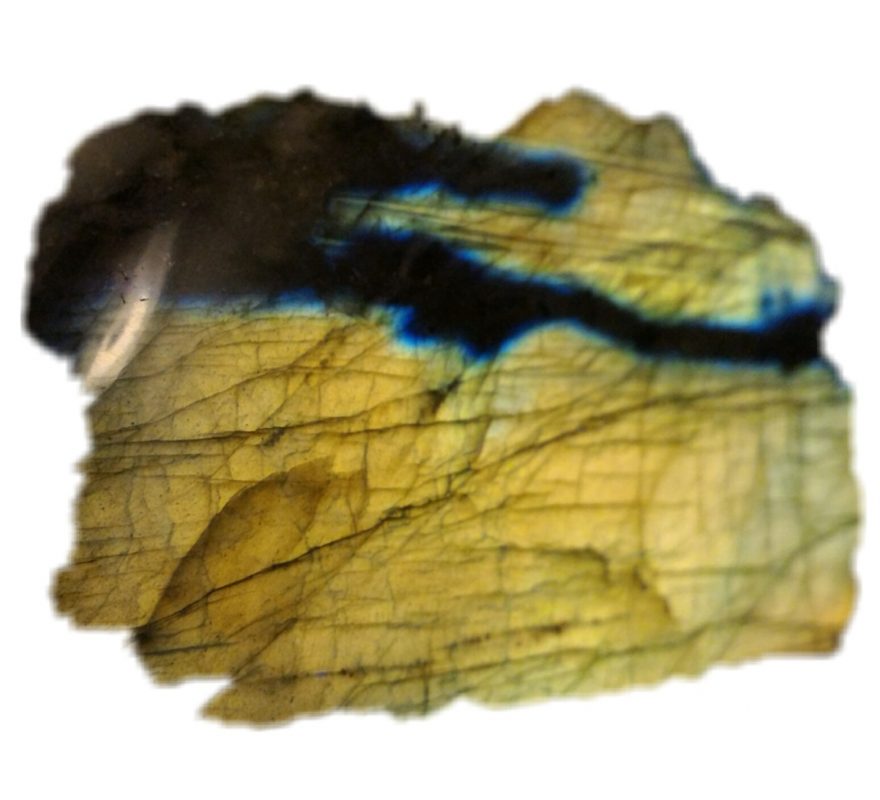
Retour à ces yeux, à ces lèvres. À cette voix ce souffle, ces deux grands yeux sombres, qui se tournèrent vers toi. Ils sont gris ces yeux et quelque part en leur fond, une voix te dit de suivre – une voix qui te dit
«écoute…
«écoute… la plus belle chose que
j’ai vue, je l’ai vue là-bas…
écoute…
je l’ai vue sur le sable
sur les dunes…»
…et puis ce matin, tôt, tu es sorti sur le pont pour regagner ta cabine. Difficile de savoir, finalement, où tu l’as
vraiment passée, cette nuit.
Tu ne sais pas, peut-être bien ailleurs…
Puis, le soleil s’annonça – une pointe de lumière, diluée dans la
mer – et tu as vu cet homme que les marins remontaient.
Ils le tiraient vers eux, lentement, hors de la mort.
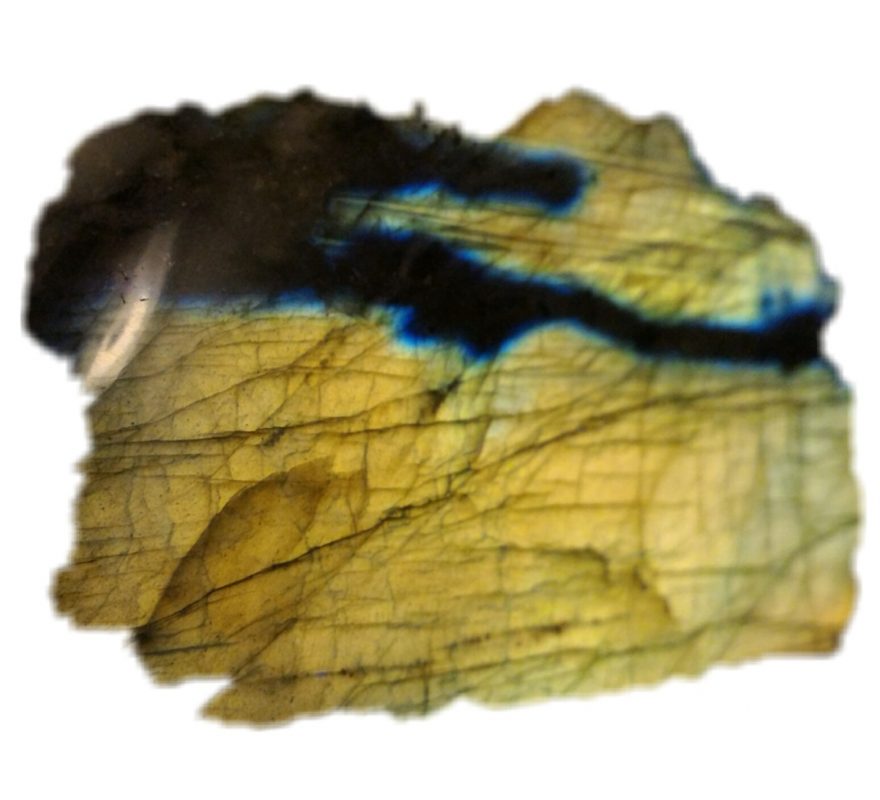
La soirée commençait à s’esquisser lorsque tu t’assis au bar, encore un peu perdu dans la nuit précédente, pour commander à boire. Quelque chose de fort, s’il vous plaît, comme au cinéma,
quand la vie se casse la gueule.
Le barman te dit
− Un whisky ? C’est du bon.
et toi de répondre, voix grave et solennelle
− Okay, un whisky.
Trente-sept secondes plus tard, une fois ton verre servi, et toi seul à une table :
− Vous avez raison, il paraît qu’il est bon ce whisky. D’ailleurs j’en ai pris un, moi aussi.
Et là, tu t’entendis répondre
− Oh. C’est vous l’homme qu’on a sauvé ce matin ?
− Vouais, c’est moi.
C’était lui, Brian Finnigan horloger irlandais, l’homme qui pendant dix-sept jours fit patienter la mort (avant de se tirer,
blablabla, sur le premier paquebot, etc.)
D’ailleurs, et pour tout dire dire, ce fut une histoire
personnelle qui le mena, lui, horloger irlandais âgé de trente-quatre ans – à marcher sur les quais d’un port d’Italie,
à la poursuite d’un homme (un homme, qui, depuis le jeudi
15 avril six ans plus tôt, quelque part dans le monde, le
fuyait à toutes jambes)
et puis à monter,
de là, sur un navire dont il ne lut pas le nom
navire qui par la suite explosa en pleine mer,
faisant plus de milles morts et un seul survivant, lui,
Brian Finnigan, horloger de génie,
Brian Finnigan qui,
suite à cet extraordinaire concours de
circonstances, fit patienter la mort pendant près de dix-huit jours, avant de se tirer à bord du premier paquebot venu croiser sa route,
pour se retrouver là,
assis,
finalement face à toi, j’te resserre un
verre Brian, oh ben oui, s’il te plait
merci,
c’est pas de refus.
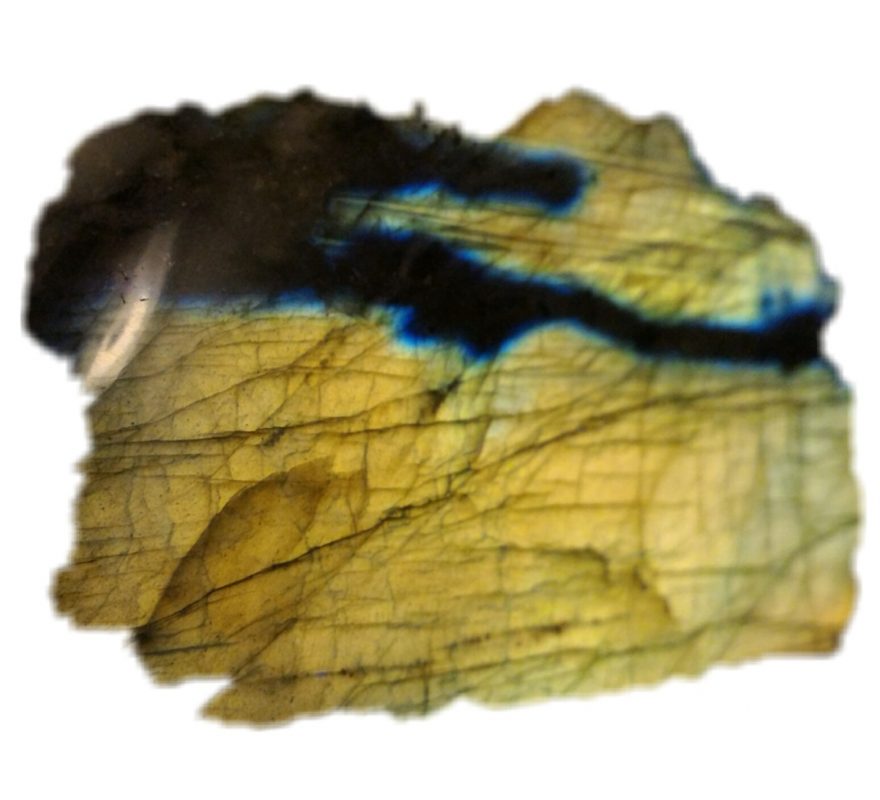
− Comment c’est arrivé ?
(ta voix, dans le silence)
je veux dire, le naufrage.
(question légitime, après tout
– on veut toujours savoir)
− Une explosion.
− Une explosion ?
− Une explosion.
Un soir, le capitaine est arrivé. Il marchait bizarrement, avec l’air de celui qui à quelque chose à dire, qui se doute bien que c’est important, mais qui ne sait pas vraiment par où commencer.
Il s’arrêta au milieu de la salle,
regarda sa montre,
attendit un peu que le silence soit total
et puis enfin, il nous dit la chose de manière assez simple :
« Mesdames et messieurs, c’est ma dernière traversée, et dans trente-quatre secondes, je vous l’annonce, tout va
sauter »
− …
− Après cela, je ne sais plus vraiment. Je vois encore ce type, là, debout, sa casquette de capitaine, son regard d’halluciné en attente de la mort – j’entends encore les secondes – toutes les
secondes, décomptées par les montres, des battements de cœurs fous et désynchronisés, et puis…
Et puis il me semble qu’effectivement, au bout de trente-quatre, tout a sauté.
C’est comme ça qu’il raconte, Brian Finnigan.
L’histoire du capitaine, des dix-sept jours en mer, et de la mort qui patiente.
Un fragment de la sienne, d’histoire.
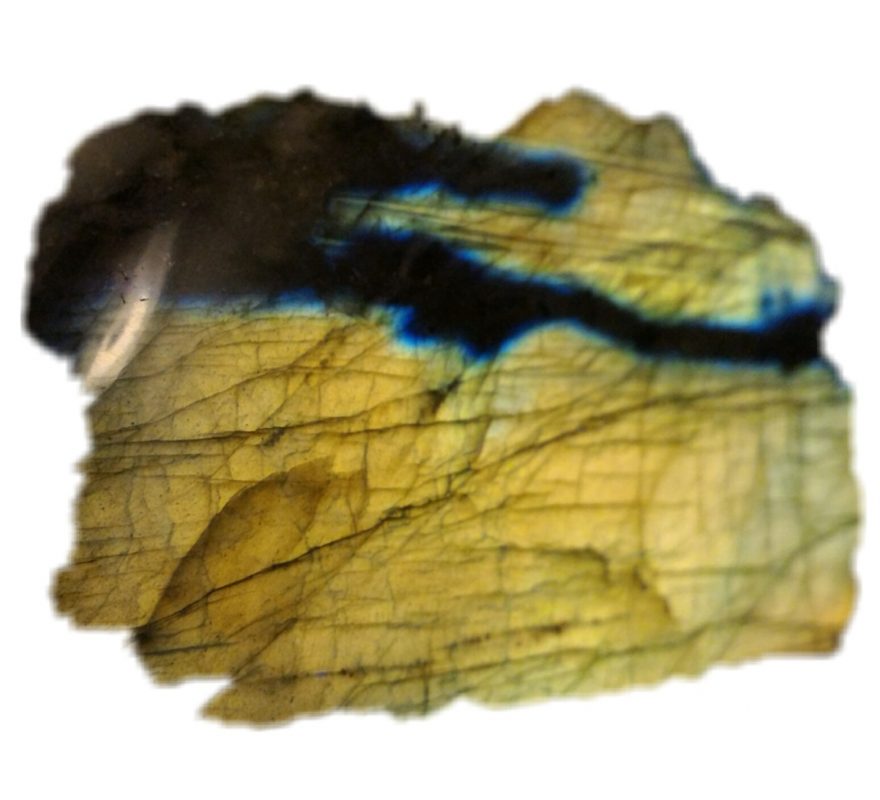
Pendant ce temps
(foudre /frayeur /fracas /torrent d’éclairs /la mer tout entière qui s’effondre /BLAM /et s’écroule sur le pont /BLAM)
la mer gronde – se soulève et s’échauffe
– fin du monde qui, lentement, se prépare.
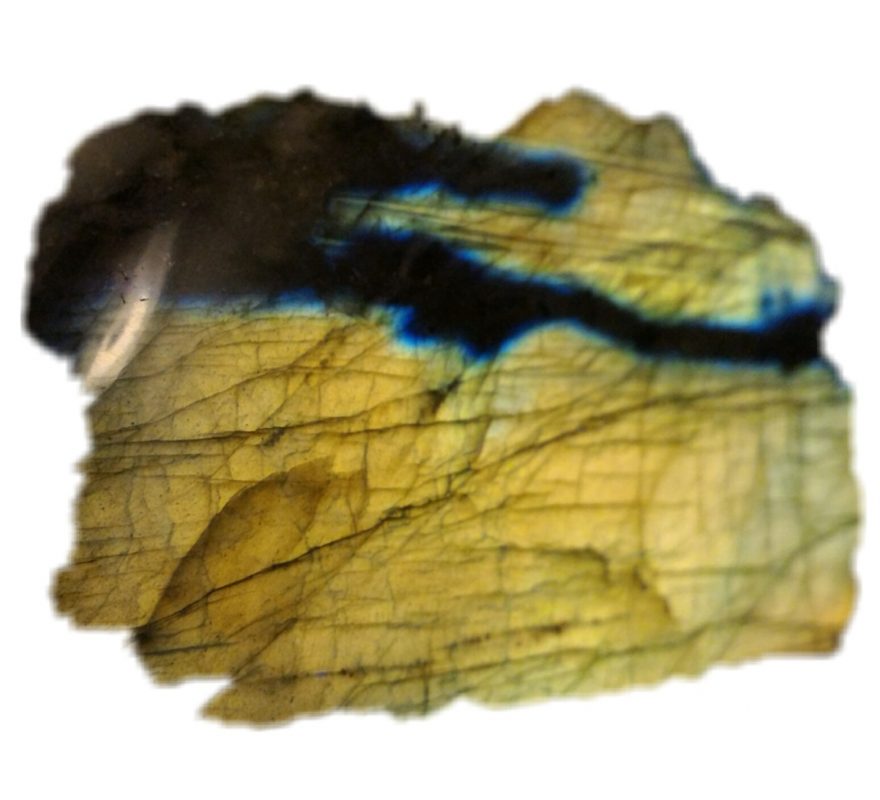
…et sur la mer, pour cette nuit son
jouet la peur se met à souffler, remue les vagues, les soulève,
les transforme et ce ne sont plus des vagues, ce ne sont que
des monstres, les vagues, des spectres gigantesques et des ombres de mort, et si les bras du kraken surgissaient, ce bon vieux cauchemar venu des profondeurs, calamar géant pour mettre un terme au voyage,
même cela,
tu t’y attendrais presque.
Et ceux qui le verraient, avec toute cette peur, ils ne pourraient que dire
«ha ça, ça j’en étais sûr. Le coup du kraken, j’en étais sûr, que ça allait m’arriver, avec ma chance, bordel, avec ma chance…»
«on va tous crever on va tous crever on va tous crever» «c’est pas vrai, il manquait plus que ça, cette saloperie géante» «ON VA TOUS CREVER ON VA TOUS CREVER» «mais pourquoi je suis monté dans ce
foutu bateau si seulement je les avais écoutés je» «ON VA TOUS
CREVER BORDEL J’EN ETAIS SUR VOUS ENTENDEZ J’EN
ETAIS SUR» «SOS SOS AU SECOURS ! LE KRAKEN VA NOUS BOUFFER C’ETAIT COURU D’AVANCE
SOS VENEZ TOUS NOUS AIDER BORDEL !»
− Panique pas, dit Brian Finnigan horloger irlandais. C’est rien ; profite que t’es au sec et raconte moi,
toi,
ce que tu fais ici, à boire comme un trou avec un naufragé.
C’est qu’il en a vu d’autres des calamars, lui, pendant ces dix-sept jours où la mort patientait.
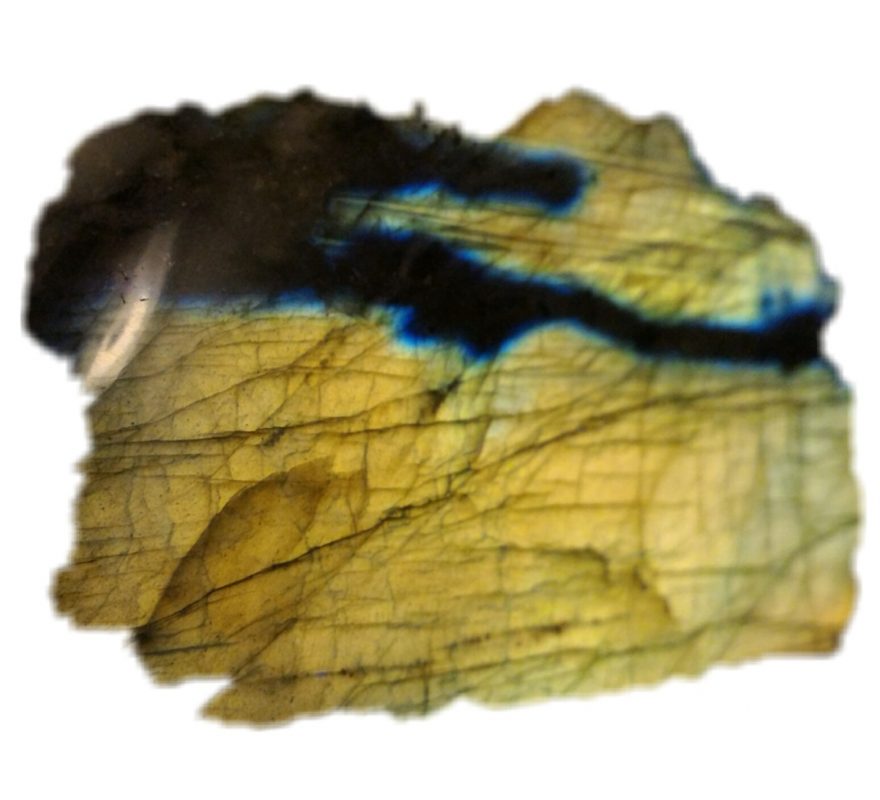
Deux grands yeux sombres, voilà le début, le point de départ.
Le début de l’histoire que tu lui racontes, toi, à Brian Finnigan.
Deux grands yeux sombres, qui s’ouvrent et se tournent vers toi.
(et ce n’était pas, ces yeux, un refuge éternel où le monde,
enfin, devenait immobile)
(C’était le monde par vagues, ces yeux, le monde qui remue de
partout – aucune terre, aucune pause, aucun abri possible face à
ce courant qui refuse de finir)
Tu lui racontes cette nuit – la nuit dernière, passée Dieu sait où, et où tu dérivais encore en commandant à boire.
(le monde/les vagues – son souffle/sa peau – cette magie de
l’avec, et dans ses yeux une voix qui appelle,
une voix qui te dit «écoute…»)
Écoute… la plus belle chose que j’ai vue, je l’ai vue là-bas…
écoute…
je l’ai vue là-bas, sur le sable
sur les dunes…
sur le sable il y avait cet homme
assis,
seul sur une chaise plantée dans les dunes…
… au milieu de ce vide qui dévore ce qui vit, qui dévore le
monde – et c’est un endroit terrible – c’est un endroit superbe –
il y avait cet homme, seul, assis, qui jouait…
… veillait face au sable, ce sable qui ronge, qui grignote peu à peu cette terre pourtant échue aux hommes –
mais si, à la rigueur,
il n’y avait qu’eux, les hommes…
… cet homme, et le vide qui s’avance, la fin qui rampe devant lui – et lui sur sa chaise, assis, saxophone à la bouche,
je te le promets
cet homme,
il joue…
Et elle vogue cette histoire – tissée de mots qui ne sont pas les tiens – c’est une histoire qui veille.
Une chandelle.
C’est une histoire qui veille pour faire passer la nuit,
pour les tenir au loin, la mort la peur la tempête,
les tenir en respect jusqu’à demain matin,
s’agripper à la vie jusqu’à demain matin.
Tenir jusqu’à l’aube et puis continuer
Tout droit
Finalement
Pour traverser la mer.
