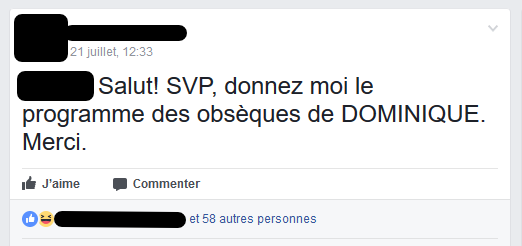« Open Defecation », la campagne qui s’est arrêtée trop vite…
Tout à l’heure en cherchant des informations pour un article, je suis tombé sur une campagne baptisée #OpenDefecation initiée par l’ONU en 2014 pour sensibiliser sur la réalité de la défécation en plein air. J’ai essayé d’en savoir plus, et les quelques données publiées dans l’article étaient effrayantes : un enfant meurt toutes les deux minutes et demie d’une maladie liée à la défécation en plein air ; 1 milliard de personnes n’ont pas d’autre choix que de déféquer en plein air, à la vue d’autres personnes. Plutôt alarmant comme données.
La première fois que j’ai été confronté au phénomène de défécation en plein air, c’était en 2010 alors que j’allais prendre service à Maroua où je venais d’être affecté. La première escale du voyage était à Ngaoundéré, dans la région de l’Adamaoua. Tandis que j’attendais le départ pour Maroua et que je cherchais un truc à manger après le long voyage que je venais de faire, je suis passé près d’un endroit où des jeunes hommes étaient accroupis, sereinement, en train de déféquer – je ne l’ai réalisé que lorsque l’un d’entre eux s’est levé.
Arrivé à Maroua, ce n’était pas différent, au contraire. On voyait régulièrement enfants et adultes (surtout les hommes), sortir de chez eux et venir tranquillement s’accroupir sous un arbre en plein air pour se soulager, sans se préoccuper des regards. Un collègue m’a raconté qu’un jour alors qu’il était en cours, un homme est venu s’accroupir juste derrière sa classe. Le collègue a alors rameuté toute la classe qui a hué le monsieur jusqu’à ce qu’il décide de s’éloigner, honteux.
Avec le temps, et peut-être à cause de la présence de plus en plus importante de « sudistes », il est devenu beaucoup plus rare de voir des gens déféquer en plein air – même s’il n’était pas rare de trouver les « traces » de leur passage ici et là, sous un arbre ou bien dans la broussaille.
Je n’avais plus été confronté à ce phénomène jusqu’à il y a peu. Mais cette fois, c’était pire. Depuis quelques mois, j’habite à quelques mètres d’un établissement primaire public. Tout près de l’établissement, deux amas d’immondices où les populations, faute de mieux, viennent déverser leurs ordures ménagères. C’est aussi sur ces ordures que viennent se soulager écoliers et écolières de l’école primaire, l’école manquant de toilettes pour les élèves.
Le plus étonnant dans tout ceci, c’est que la délégation départementale de l’éducation de base du Nyong et So’o est située juste à côté de l’école, et elle possède des toilettes qui sont toujours fermées à clé ! Ces toilettes sont donc inaccessibles aux élèves qui sont obligés de se soulager sur les détritus, avec tous les risques potentiels que cela peut avoir sur leur santé.
Le problème de non disponibilité de toilettes pour les élèves dans les établissements scolaires est crucial. Cette infrastructure, malgré son importance, semble être facultative dans la conception de beaucoup de d’établissement. Pourtant, de études montrent que l’absence de toilettes a un impact négatif sur l’éducation en général, et sur l’éducation des jeunes filles en particulier.
L’absence de toilettes ou de latrines a des conséquences inimaginables. En plus des nombreux décès (près de 2.000 enfants par jour selon les chiffres de 2014) dus aux maladies liées à la défécation en plein air, il y a les cas décrochage scolaire. « L’UNICEF estime même que 272 millions de journées d’école sont perdues à cause de la diarrhée », lit-on dans un article publié en 2014 sur le site reliefweb.int.
Les jeunes filles souffrent encore plus de cette absence de latrines dans les établissements scolaires : « le manque de toilettes privées dans les écoles est l’une des principales raisons pour lesquelles les filles abandonnent leurs études une fois la puberté atteinte ».
L’absence de toilettes aurait également des effets sur la croissance des enfants. En Inde (le pays où la défécation en plein air est le plus pratiquée), 2 enfants sur 5 de moins de 5 ans souffrent d’un retard de croissance. La cause, selon un article publié en 2016 sur le site Thomson Reuters Foundation News, c’est que la défécation en plein air augmente les risques de contamination de l’eau, dont la consommation cause les diarrhées qui elles-mêmes entraînent le retard de croissance, tout en perturbant les études des enfants qui en souffrent.

En Afrique aussi, les retards de croissance sont nombreux et le phénomène de défécation en plein air récurrent, 60% de la population n’ayant pas accès à des toilettes décentes. Au Nigeria par exemple, plus de 10 millions d’enfants en souffrent. Et, bien évidemment, la défécation en plein air y est pratiquée.
Selon les informations glanées sur internet, dans le cadre de la campagne #OpenDefecation, plusieurs actions ont été menées dans différents parties du monde pour doter des villages en toilettes et ainsi contribuer à réduire les effets négatifs dûs à leur absence. Malheureusement, la campagne semble aujourd’hui arrêtée : le site internet de la campagne est inaccessible, et le compte twitter dédié semble inactif depuis 2016. Une campagne que l’on gagnerait à relancer, vu les conditions d’insalubrité dans lesquelles une grande partie de la population mondiale vit.