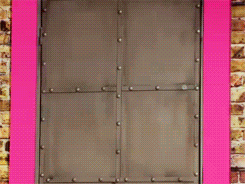Miroir, miroir, dis-moi qui je suis ?
En France, ces derniers mois sont remplis de discours d’oppositions brutales. Es-tu de gauche ou de droite ? Es-tu de souche ou es-tu immigré ? Es-tu pro-palestinien ou pro-israélien ? Manges-tu bio ou trouves-tu que les fruits et légumes sont trop chers ? Comme si ce qui nous définit était d’un côté ou de l’autre. Pourtant, chaque individu est une palette d’identités…