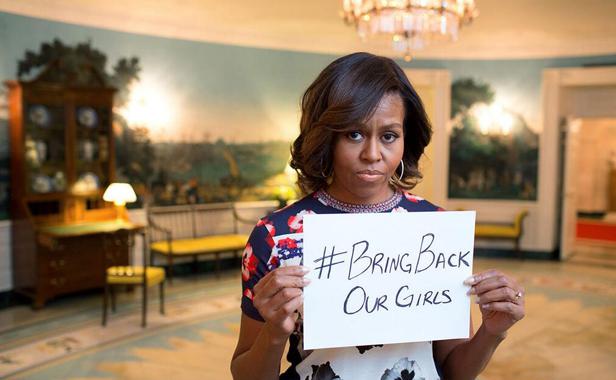Ce n’est pas par l’odeur du pet qu’on reconnaît un vieux (8e partie)
Pour qui sont ces poils de mon pubis dans tes mains?
K2 rentra chez lui avec le somnifère, aussi excité qu’un commerçant guinéen devant le soutien-gorge d’une tapineuse nigériane. Au salon, il dépassa Matou, allongée dans le fauteuil, les yeux rivés sur l’écran de la télévision, la télécommande scotchée sur sa chaîne préférée Trace Africa qui passait un de ses clips préférés, un succès des talentueux X Maleya : « Bouge ton corps si tu aimes, un deux trois, on descend, on descend, on descend yééééyé… »
Elle ne se donna même pas la peine de lui lancer une pestiférée « Bonne arrivée », comme le fait toute femme normale à son mari. « Sale petite peste, on verra si tu continueras de bouger ton corps devant et sous tous les vagabonds de Bamako. Astafourlaï ! Que je sois un Konaté maudit à jamais si tu ouvres encore tes cuisses légères-là à un homme de ce pays à part moi », jura l’inspecteur des Impôts de classe exceptionnelle en rentrant dans la chambre à coucher.
Un vieux lion n’a point besoin de conseil pour attraper une antilope, que dit le dicton. Kader Konaté ne réfléchit pas longtemps avant de savoir quel piège à tendre à « Espace Schengen » pour lui faire boire le somnifère. Vraie friande de jus de fruits, elle en buvait trois à quatre boîtes tous les jours. Le chasseur futé sortit donc, chercha une boîte de jus à la grenadine, l’ouvrit furtivement, y déversa toute la poudre soporifique, la plaça dans le frigo sous l’œil de la Matou, puis alla se placer à l’affût, dans la chambre à coucher, attendant que l’écureuil mît ses pattes dans le piège.
Quand il revint au salon, autour de minuit, sonder le piège, K2, malgré l’état de déliquescence avancée de ses articulations, sauta de joie, voyant Matou allongée sur le plancher, morte de sommeil, ronflant bruyamment, les deux cuisses écartées comme une actrice en chaleur s’apprêtant à accueillir en elle Rocco Siffredi. « Tu te crois forte et rusée non, petite prostituée, aujourd’hui je vais te prouver qu’on ne met pas le doigt dans l’anus d’une tortue », ricana-t-il, revanchard.
Il chercha une lame, enleva doucement la légère robe que portait la jeune femme, ôta délicatement son string, s’étonna un moment qu’elle s’était fait tatouer des formes bizarres sur ses cuisses, et des prénoms de garçons, ses amants sans doute, sur son ventre, voulut éclater en sanglots en criant « Allah, oh Allah, pourquoi m’as-tu ainsi fait cocufier ? », se ressaisit rapidement en concluant que ce qui était consommé était déjà consommé, il fallait juste fermer définitivement le robinet public, et commença, serein, à lui couper les poils des aisselles puis du pubis –elle en avait, alhamdoulilaye ! –
Il sonnait minuit trente minutes quand K2 s’attaqua aux ongles de Matou qui dormait toujours profondément. Minuit trente, heure très avancée dans ce quartier périphérique de Bamako où les habitants normaux avaient depuis longtemps rejoint leur lit, laissant les lieux aux apôtres des ténèbres : la pute ivoirienne ou togolaise rentrant chez elle avec son deuxième client de la soirée, la mariée matérialiste et infidèle partie chercher l’argent de son basin du mariage du dimanche sortant de la chambre des adultères sur la pointe des pieds, le gardien Dogon culbutant au Viagra traditionnel dans une maison inachevée la servante peuhle du voisin, le chômeur de longue date reconverti en voleur de motos Jakarta escaladant son premier mur de la nuit, le dealer ibo à l’affût d’un talibé étourdi à assassiner pour aller vendre le sang et le cœur à des aladjis fétichistes, la blessée de guerre de 26 ans, dévaluée par un enfant bâtard coincé dans le soutif, déversant au carrefour son énième sacrifice pour attacher le cœur de ce jeune diasporique lui ayant promis le mariage depuis quatre ans mais qui ne fait même plus signe de vie…
Minuit trente, heure louche, heure de malheur ! K2 la sentit d’abord pousser un lourd ronflement, puis un petit cri de douleur, il la vit ensuite bouger la tête, puis bouger les cils avant d’ouvrir les yeux. Il l’écouta hurler d’horreur, alors qu’il était, figé d’étonnement, toujours accroupi sur elle, sa lame près de sa main droite dont il coupait les ongles. Il la vit se redresser brusquement sous un grand cri, se voyant nue alors qu’elle s’était endormie habillée, et voyant à côté d’elle, sur un petit mouchoir blanc, ses poils et ongles coupés. Il ne put la maîtriser quand d’un geste brusque elle le poussa des deux mains, l’envoyant s’écrouler, gringalet, sur le plancher, avant de se saisir de sa robe, l’enfiler rapidement, sortir de la chambre en courant, se jeter dans le noir de la cour, hurlant : « Au secours, aidez-moi, aidez-moi hooooooooo, mon mari veut m’assassiner, ce vieux sorcier veut me tuer, hoooooo, aidez-moi, le sorcier Konaté veut me tuer… »
A suivre…