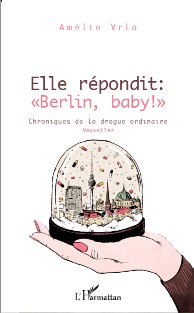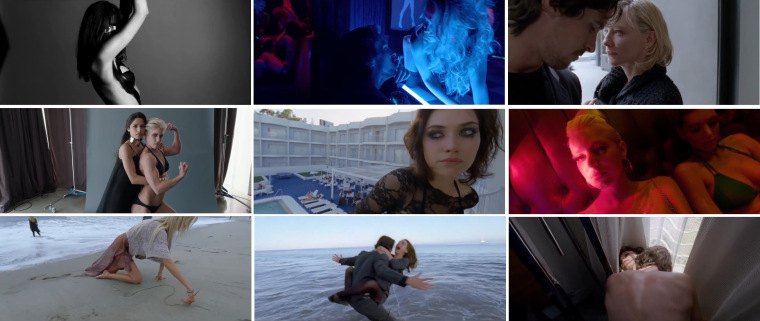Transsibérien: écriture et passage de frontières
C’est cette fois non plus sur le Ring berlinois que Nicolas Ancion (auteur belge que j’avais eu le plaisir de rencontrer lors de l’événement « Litteratur auf dem Ring » en février dernier) a décidé de s’embarquer, mais sur le mythique train qui relie Moscou à Vladivostock, entre autres: le Transsibérien.
Un voyage auquel j’avais dû moi-même renoncer il y a quelques années, et qui continue de titiller mon imaginaire…
Entretien sur les rails avec un écrivain que les voyages et le passage de frontières inspirent.
Pourquoi avoir choisi de voyager sur le Transsibérien en particulier? Était-ce un but en soi? Un moyen de transport comme un autre? Y avait-il une envie de prendre part à un mythe?
Depuis cinq ans, nous passons au moins trois mois par année en voyage, en famille. Nous aimons beaucoup l’Asie, mais nous n’avions jamais eu l’occasion d’y aller par la terre. Mes enfants (qui ont 12 et 14 ans) et ma femme avaient très envie d’effectuer le périple par la terre, depuis le cœur de l’Europe jusqu’au ventre de l’Asie.
Il y a un gouffre entre l’image qu’on se fait des trains de légende et leur réalité concrète. Le transsibérien n’existe pas vraiment, ou plutôt ce n’est pas un moyen de transport. C’est une ligne de chemin de fer, pas un train somptueux, comme l’Orient-Express qu’on représente dans les films.
Le train a-t-il un caractère mythique, ou est-on déçu en y montant? Qu’est-ce qui fait la spécificité de ce train et de ce voyage, et pourquoi fascine-t-il ou déçoit-il au contraire?
Le train en lui-même décevra le voyageur qui s’attendrait à monter à bord d’un engin unique en son genre, façon Concorde ou Titanic. Pour ma part, c’est une des découvertes du voyage : chaque nouvelle portion du trajet nous a permis de découvrir des voitures différentes. Aucun wagon restaurant n’est semblable, le menu varie à chaque fois…
Il est connu que les voyageurs sur le Transsibérien ont souvent recours à la vodka pour créer des liens, selon le fameux slogan “Vodka connecting people”. Toi qui y as voyagé en famille, avec tes deux enfants, comment s’est passé le contact avec les autres voyageurs?
Quand les Russes ou les Mongols montent dans le train, ils passent en mode « voyage » : ils retirent leurs bottines et enfilent les tapochkis, des pantoufles soit en plastique (qu’ils ont emportées avec eux) soit jetables (offertes par les chemins de fer à chaque passager). Ils laissent la porte de leur compartiment ouverte et les malheureux qui sont logés dans les couchettes du haut passent une bonne partie du trajet debout dans le couloir. Comme nous étions quatre, nous avons systématiquement choisi de rester ensemble dans le même compartiment.
Le point commun entre tous ceux qui sont sur la route est une passion pour la malbouffe : soupes chinoises industrielles, chips, bouteilles de soda par sacs entiers.
Au fond, le train n’est pas très différent des villes qu’il relie et traverse. Pour ma part, je n’ai ni vu ni bu de vodka pendant le trajet. Ce qui a permis les contacts, c’est plutôt mon multiprise pour partager les rares prises électriques fonctionnelles dans les couloirs.
Blaise Cendrars avait écrit “La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France”, sans jamais être monté dans le célèbre train. Est-il pour toi un lieu d’inspiration?
L’inspiration fonctionne en deux temps : je n’écris jamais sur ce que je vis ou ce que je vois. Quand je suis dans l’écriture, je m’extrais du lieu où je suis, c’est ce qui me permet d’écrire sur n’importe quel sujet n’importe où. Je n’utilise ni l’observation ni la retranscription de ce que je ressens ou redoute, mon écriture est toujours un travail de pure fiction. Cependant, à long terme, mon imaginaire est fatalement contaminé par ce que je vis, découvre, explore, lis. Il y a déjà eu des trains dans mes histoires et il y en aura encore…

Il y a plusieurs années, je devais moi-même monter à bord du train pour faire Moscou-Beijing, mais j’ai dû y renoncer et rentrer en France car ma grand-mère adorée venait de décéder. Pourquoi ta famille et toi choisissez-vous de voyager ensemble?
Voyager est un moyen de passer trois mois en famille, quasiment vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ce que nous aimons beaucoup. La première fois que nous sommes partis en Asie, nous avons dû revenir d’urgence en Belgique pour accompagner les derniers moments de la grand-mère de nos enfants, qui avait voyagé toute sa vie. Nous leur avons promis alors de revenir voir Singapour que le retour prématuré nous avait empêchés de découvrir. Nous sommes revenus depuis, nous sommes repartis sur d’autres continents, c’est une chance de pouvoir travailler partout dans le monde et, pour mes enfants, d’étudier et de découvrir la planète en même temps.
Le Transsibérien est-il un voyage que tu conseillerais de faire aux jeunes adultes ou artistes ?
Tous les voyages nourrissent, mais on n’y trouve jamais que ce qu’on est venu y chercher : le dépaysement, le ressourcement, la solitude ou la fête, les choix sont innombrables. Ce qui est formidable avec ce long trajet en train, c’est le retour à un univers sans connexion (mais pas sans ordinateurs, car il y a des prises électriques). Et l’absence de connexion est toujours très productive, pour la concentration.

Quel est le pays, la ville ou l’endroit qui t’as le plus marqué au cours de ce voyage ?
Je pense que les endroits les plus marquants n’ont même pas de nom, dans mon esprit. Ce sont ces villages en Sibérie, dont la majorité des maisons semblent abandonnées et dont on se demande à quoi ressemblent les derniers habitants. Ils sont à des heures de route de toutes les villes et, dès octobre, la neige vient blanchir les toits. De quoi vit-on dans de pareils lieux ?
Quelle a été l’expérience la plus désagréable ?
Sans hésitation, c’est le moment où le train local ralentit en gare de Vladimir, première étape après Moscou, et que nous disons aux enfants de descendre tandis que je tire les valises. Ma fille descend sur le quai dans la nuit russe et… les portes se referment au nez de son frère. Le train redémarre, laissant ma fille de quatorze ans sur un quai de banlieue d’une petite ville russe. Nous avons tambouriné en vain sur la porte, tenté d’actionner tous les leviers. Heureusement, ma femme parle russe et a hurlé en direction d’un groupe de policiers assis dans le train pour rentrer chez eux. Ils ont actionné le système de freinage et avertit le conducteur par l’interphone. Ma fille a pu remonter dans le train, tremblante. Elle avait vu le train repartir sans elle, dans la nuit. Malgré les dizaines de secondes de panique complète, tout s’est arrangé. La gare où nous devions descendre était à une dizaine de kilomètres de là…
Y avait-il un élément du voyage auquel tu ne t’attendais absolument pas, qui t’as véritablement surpris, en bien ou en mal ?
Je me suis découvert une allergie aux couvertures mongoles en poil de chameau. J’ai été couvert d’urticaire pendant dix jours après le train de nuit entre Oulan-Bator et la frontière chinoise.
Si tu devais résumer ce voyage en une phrase ou un mot, quel serait-il ?
Peut-être qu’“apaisant” est un bon terme.
En tout, le périple de Saint-Pétersbourg à Pékin a duré un peu plus de trois semaines. Après quelques étapes, les heures de train et les nuits en couchettes nous semblaient si familières et confortables, que notre compartiment était comme un cocon mobile, monté sur rail, qui permettait, sans urgence, de passer de l’Europe à l’Asie à vitesse humaine.
Contrairement à l’avions qui bouleverse les cycles naturels du corps, impose le décalage horaire et les repas cadencés, le train respecte le cycle habituel des jours et des nuits, des repas. Il oblige aussi le voyageur à accepter la lenteur (toute relative) et à admirer la ponctualité de ces machines qui partent et arrivent à l’heure exacte en traversant pourtant six fuseaux horaires et trois pays immenses.