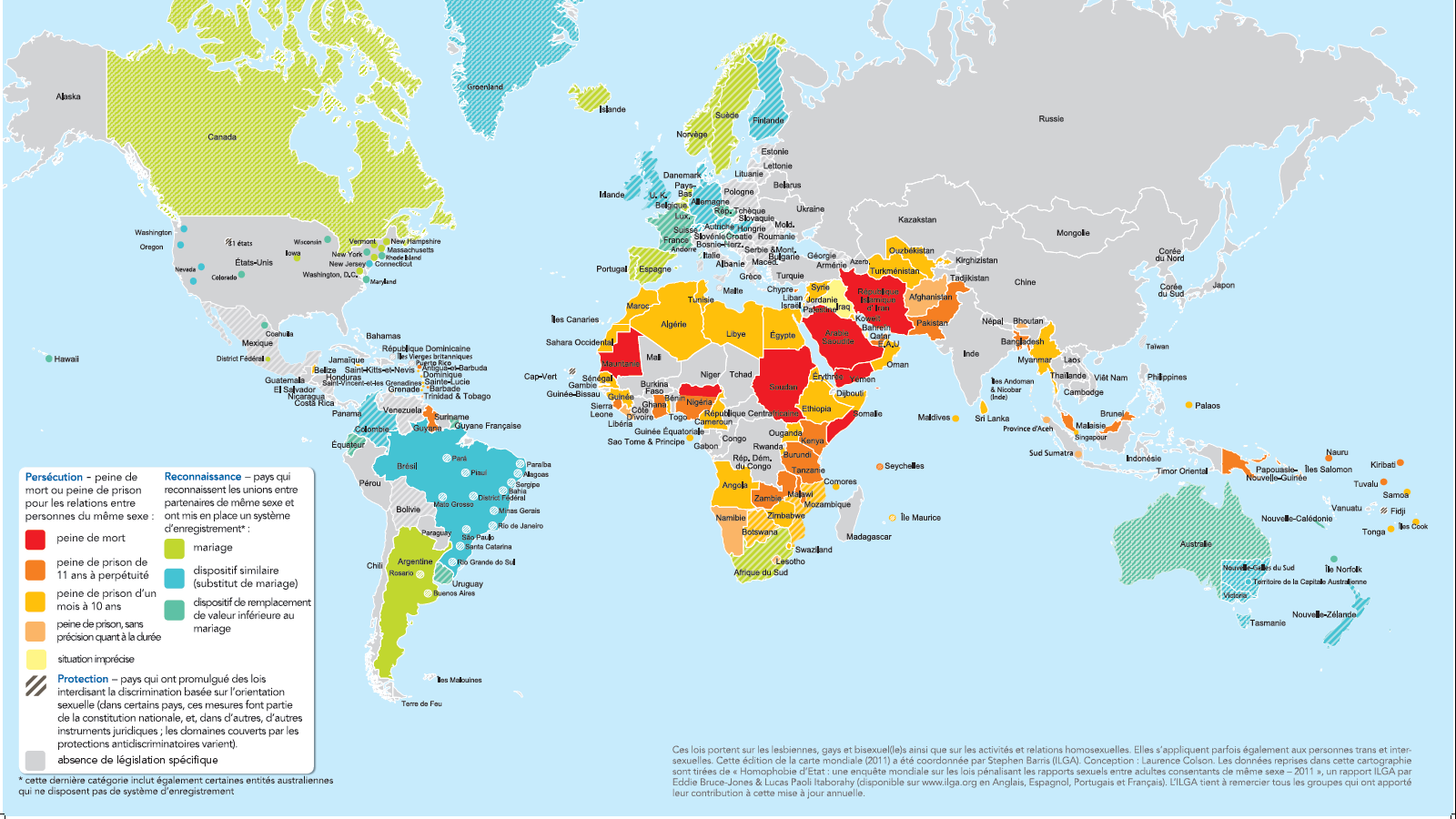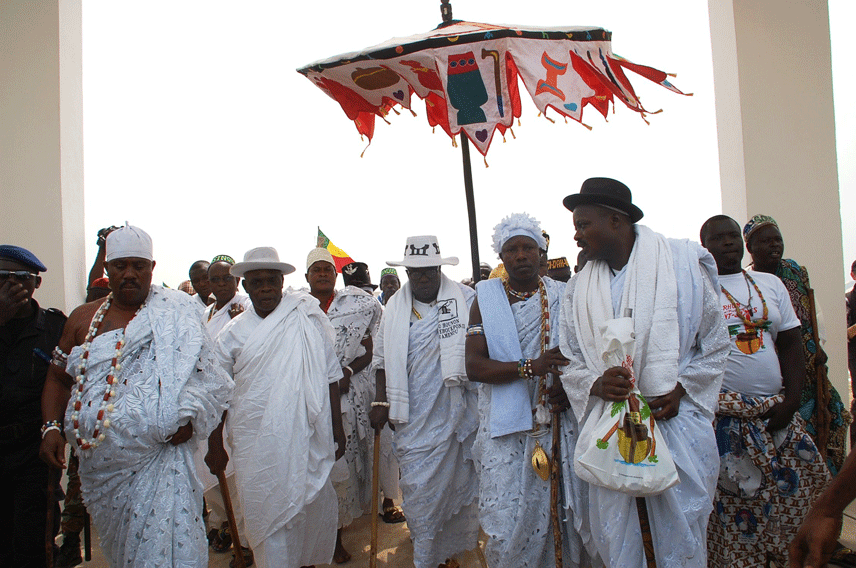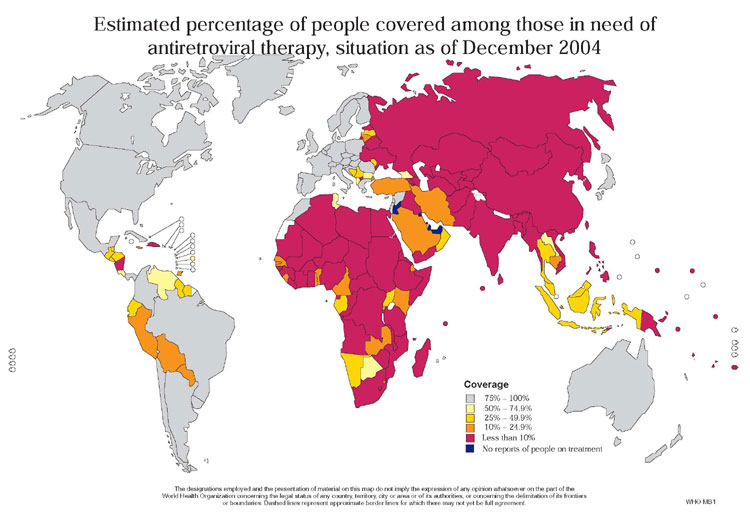Karim Sy: l’Afrique doit « passer de la position d’assistanat à celle d’acteur »
 Karim Sy (43 ans) est un serial entrepreneur Franco-malien d’origine sénégalaise. Il a grandi entre le Mali, l’Ethiopie, la Côte d’ivoire, la France et le Canada où il fait des études en génie informatique à l’école polytechnique de Montréal. Après avoir créé plusieurs sociétés dont une de forage hydraulique et minière et une autre d’aviation d’affaires au Mali, il décide en 2010 de créer un espace de co-working au Sénégal. Jokkolabs est le premier espace de co-working (travail collaboratif) en Afrique de l’ouest et même en Afrique francophone. Le nom Jokko est une contraction de « Joxko » (donne-lui) et de « Jokto » (rejoins-le). Jokkolabs est un hub d’innovation technologique et un laboratoire numérique où se côtoient développeurs et entrepreneurs engagés dans les nouvelles technologies. Un concept qui s’est rapidement essaimé dans différents pays africains. Après Dakar, Bamako, Ouagadougou, Abidjan et Nanterre en France, Karim Sy, Catalyseur de créativité collective ambitionne d’ouvrir un hub « Jokkolabs » au Bénin. Nous l’avons rencontré lors de son passage à Cotonou. Il explique la philosophie de Jokkolabs et prône un développement de l’Afrique à travers l’économie numérique.
Karim Sy (43 ans) est un serial entrepreneur Franco-malien d’origine sénégalaise. Il a grandi entre le Mali, l’Ethiopie, la Côte d’ivoire, la France et le Canada où il fait des études en génie informatique à l’école polytechnique de Montréal. Après avoir créé plusieurs sociétés dont une de forage hydraulique et minière et une autre d’aviation d’affaires au Mali, il décide en 2010 de créer un espace de co-working au Sénégal. Jokkolabs est le premier espace de co-working (travail collaboratif) en Afrique de l’ouest et même en Afrique francophone. Le nom Jokko est une contraction de « Joxko » (donne-lui) et de « Jokto » (rejoins-le). Jokkolabs est un hub d’innovation technologique et un laboratoire numérique où se côtoient développeurs et entrepreneurs engagés dans les nouvelles technologies. Un concept qui s’est rapidement essaimé dans différents pays africains. Après Dakar, Bamako, Ouagadougou, Abidjan et Nanterre en France, Karim Sy, Catalyseur de créativité collective ambitionne d’ouvrir un hub « Jokkolabs » au Bénin. Nous l’avons rencontré lors de son passage à Cotonou. Il explique la philosophie de Jokkolabs et prône un développement de l’Afrique à travers l’économie numérique.
Vous avez été de passage à Cotonou pour rencontrer des jeunes de la communauté web. Pourquoi avoir voulu vous entretenir avec eux
L’initiative « Jokkolabs » a aujourd’hui 4 ans. Elle vise à inspirer et développer une communauté d’entrepreneurs collaboratifs pour inventer une prospérité partagée. On est présent sur les différentes plateformes au niveau virtuel, via notre site et sur les réseaux sociaux… Nous avons beaucoup de gens qui nous suivent un peu partout. Il s’agit de créer un lien qui soit plus fort que le lien virtuel. Nous n’avons pas encore de hub physique d’innovations technologiques au Bénin. L’idée c’est d’échanger avec tous ces entrepreneurs qui nous suivent, avec qui on peut créer un lien plus fort et voir à terme comment on peut développer quelque chose au niveau du Bénin.
Vous avez donc appréciez l’intérêt que ces jeunes vous ont accordé ?
Oui bien sûr ! C’est ça l’idée. Partout il y a des entrepreneurs, des gens qui font des choses. Il faut prendre le temps d’identifier tous ces talents-là. Si on découvre le Stev Jobs ou le Mark Zuckerberg du Bénin, tout le monde va être content ! Les talents sont partout, il faut leur donner du temps. C’est un combat que nous avons décidé de faire il y a 4 ans. Cela fait partie de notre challenge.
Expliquez-nous un peu le contexte dans lequel Jokkolabs est né ?
Quand nous voyons le contexte de crise dans lequel on est aujourd’hui au niveau mondial et plus particulièrement au niveau de l’Afrique, nous voyons bien que nous arrivons à un changement porter par les technologies. Il y a une vraie transformation qui se passe quand on parle de troisième révolution industrielle. L’idée c’est de penser comment on va se réinventer une nouvelle manière de vivre ensemble, de s’organiser et de transformer la société. C’est cela d’ailleurs la « société de l’information » dont on parlait il y a un moment. Il faut donc penser cette « société de l’information », penser comment nous allons devenir acteur de cela et non pas juste le subir… On a aujourd’hui des technologies qui ont une croissance exponentielle. On voit aujourd’hui comment le mobile a évolué et est devenu même un mini-ordinateur. Comment nous-nous adaptons à tout cela ? Même pour des questions sociales, comment nous éduquons nos enfants avec internet où ils peuvent avoir accès à tout ? L’Afrique, tout le monde le reconnaît comme le continent du futur. Elle détiendra la troisième population du monde d’ici 2050. Nous avons des perspectives extraordinaires. Nous avons des ressources naturelles, nous avons une population majoritairement jeune. L’Afrique représente une opportunité qui est aussi porteur de risques et de dangers. Il faut donc passer de la positon de l’assistanat attentiste à devenir acteur. C’est un peu cela Jokkolabs.
Jokkolabs s’est implanté un peu partout en Afrique de l’ouest et est déjà en France depuis un moment. Le succès de Jokkolabs vous a-t-il surpris ?
Pour moi ce n’est encore un succès. On espère pouvoir aller beaucoup plus loin. On est plutôt content de voir qu’effectivement les hypothèses qu’on avait formulées de dire qu’il y a du talent partout, qu’il y a des gens qui veulent s’engager et qui n’attendent pas, sont justes. Quand on dit, passer de la logique d’assistanat à une logique où on se prend en charge, on se développe soi-même et on avance, c’est quelque chose de vraiment nouveau. On a toujours eu l’habitude d’attendre les ONG, d’attendre les partenaires au développement. Et c’est comme si on ne peut pas le faire seul. Mais en fait, on se rend bien compte que finalement, on remonte ses manches et on y va petit à petit. C’est ça l’histoire de la vie. On commence tout petit et on grandit. Et là c’est ce qu’on fait. On commence à grandir et on voit les gens qui commencent à nous rejoindre. Là on va bientôt ouvrir au Maroc et dans d’autres pays. On a déjà ouvert en France (Nanterre). Donc on dépasse même le cadre de l’Afrique.
Vous pensez réellement que l’Afrique peut se développer à travers les innovations technologiques ?
C’est clair !
Avec l’absence de politiques publiques…
A un moment donné, on aura besoin de politiques publiques. « Facebook » a démarré dans une école, dans une chambre d’étudiants. Vous imaginez la puissance de « Facebook » aujourd’hui. Ça c’est une société. Pourquoi vous pensez qu’on ne pourra pas le faire en Afrique. Et en plus on a une chance. Cette révolution industrielle qui est en train de se passer aujourd’hui, forcément cela appelle à la destruction d’un ancien modèle.
La chance que l’Afrique a aujourd’hui, c’est que quelque part notre retard devient un avantage.Parce qu’on n’a pas un ancien modèle qu’on va détruire. On va mettre en place un nouveau modèle. La question est d’avoir cette capacité d’innovation et d’anticipation qui nous permette de penser les solutions. Les universitaires de la « Singularity University » – l’organisation d’universitaires qui travaille sur la prospective technologique aux Etats-Unis – vous disent que celui qui va faire le changement, ce n’est pas le mec qui va sortir le dernier réseau social, c’est celui qui va faire sortir la technologie qui va répondre aux problématiques du monde de demain. Cela va être l’accès à l’eau, la nourriture, l’électricité, les énergies renouvelables. Ce sont des problèmes qu’on a, des problèmes de développement.
Internet est venu en Afrique dans les années 2000, pourquoi avoir attendu 2010 avant d’avoir un premier espace de co-working en Afrique de l’ouest ?
Déjà que cela n’est pas forcément lié à internet. Plus qu’un espace de co-working, je me suis dit qu’il faut qu’on ait cette approche qui est en plein dans la culture digitale. Et la culture digitale aujourd’hui, ce sont des communautés qui sont horizontales, non centralisées, non pyramidales et sans hiérarchie. C’est ça qui perturbe tout le système. Parce qu’aujourd’hui cela remet tout en question. Vous, vous êtes de la presse. Mais la presse a été complètement remise en question. Même les politiques sont remis en question parce qu’ils sont interpellés. On voit bien que tous les systèmes sont remis en question par cette nouvelle organisation. Et ça, déjà il fallait bien que l’Afrique l’atteigne. Internet, bien vrai cela a commencé à entrer en 2000, mais aujourd’hui encore, c’est un secteur qui est trop faible. Jusqu’à présent on ne parle pas encore d’économie numérique en Afrique. On parle plus de télécoms (…). Et les opérateurs de téléphonie mobile génèrent tellement d’argent qu’ils ont attiré l’œil de tout le monde. Le débat a tourné autour et Cela a donné cette fausse impression que c’est un secteur qui va bien. Alors qu’en fait c’est juste l’arbre qui cache la forêt. On n’a pas pris le temps de véritablement développer l’économie en tant que telle. C’est-à-dire, et une économie en propre et une économie qui va permettre de vraiment accompagner la compétitivité du secteur ancien de l’agriculture, des industries…
L’environnement béninois serait-il propice à l’installation de Jokkolabs ?
Tous les environnements sont propices. Parce que partout il y a des entrepreneurs, partout il y a des talents.
Propos recueillis par: Hermann BOKO