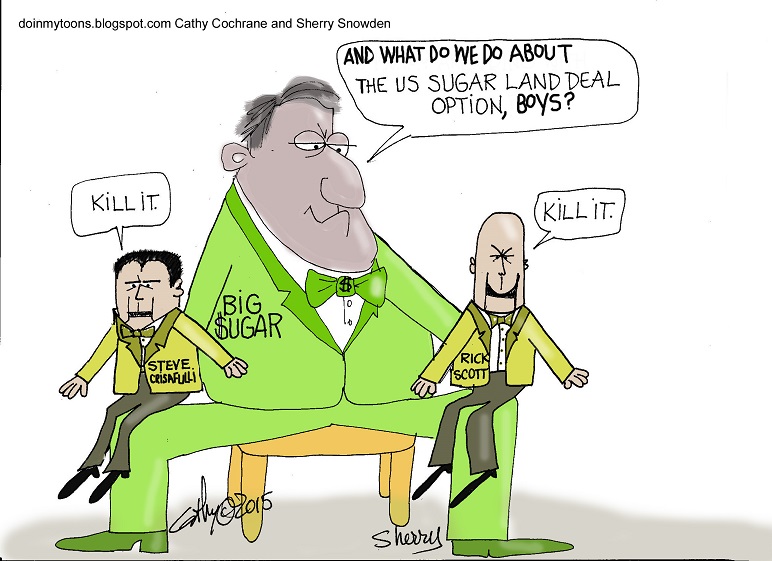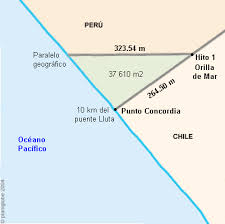Aux réfugiés, l’OFPRA pose «beaucoup de questions», mais «ils sont gentils»
Le monde compte plus de 20 millions de réfugiés, et le 20 juin leur est dédié. En France, pour obtenir ce statut particulier, les personnes doivent se présenter à l’OFPRA, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Cette administration qui dépend du ministère de l’Intérieur français a reçu plus de 85 000 demandes de protection en 2016. Environ une sur trois est acceptée. Dans ses locaux, les entretiens se succèdent.
Pour Radio France internationale, j’ai pu assister à un entretien d’un de ces demandeurs d’asile. J’ai aussi parlé avec les responsables de l’OFPRA et des associatifs qui collaborent avec l’institution pour aider les réfugiés.
Présentation : Anne Soetemont
Réalisé avec l’aide des équipes de RFI
Vous pouvez retrouver la version web de ce reportage sur RFI ou sur InfoMigrants. Pour informations, voici quelques chiffres concernant les réfugiés en France – ils ont été produits par l’OFPRA dans son rapport d’activité 2016.