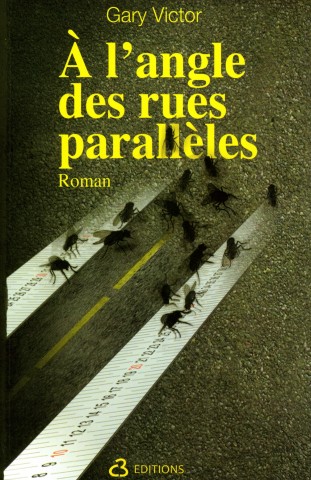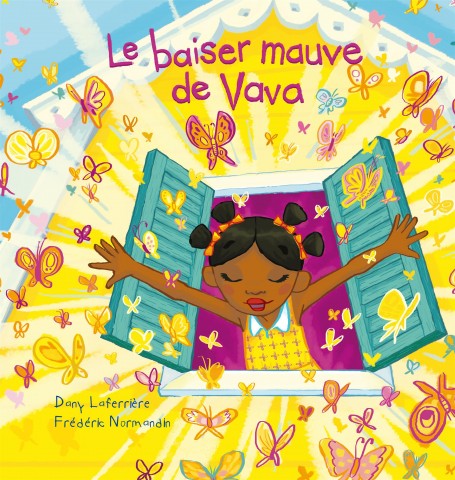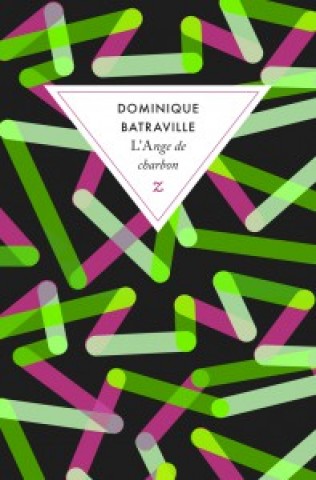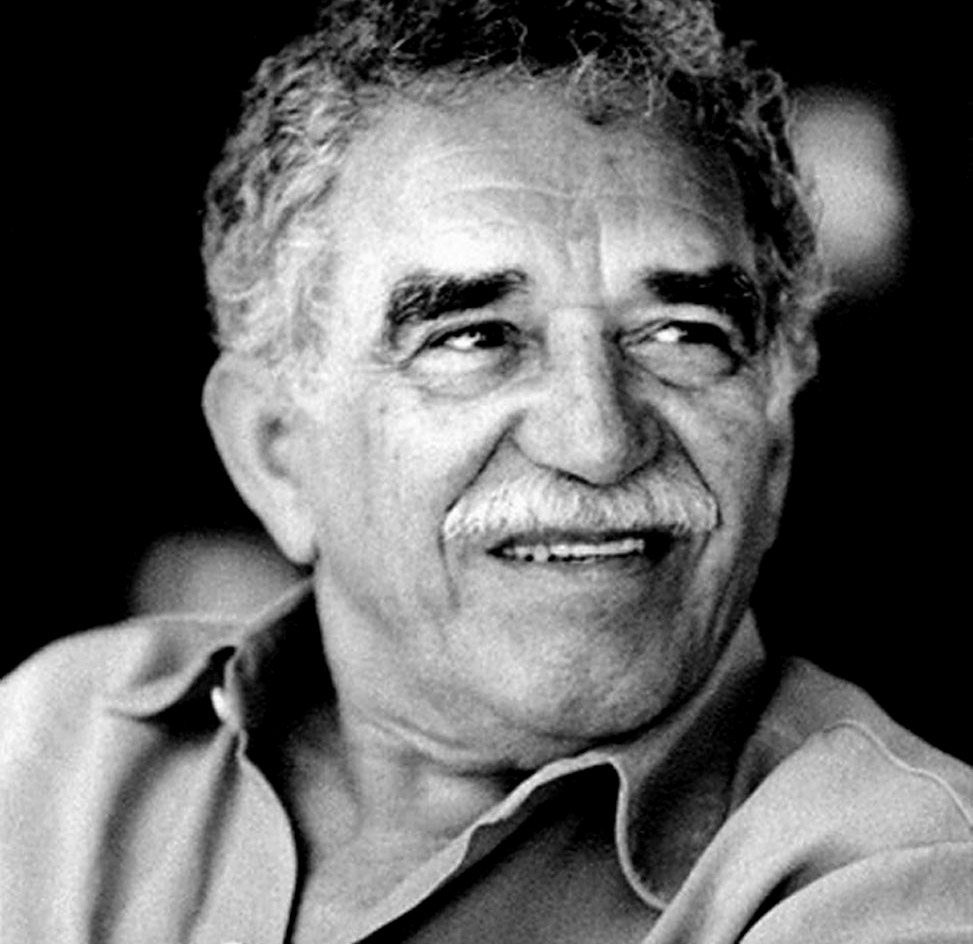La camionnette rouge
Ce texte est le premier chapitre de la nouvelle La camionnette rouge qui a été finaliste du Prix du jeune écrivain francophone à Muret (France) en 2013. Toute reproduction de ce texte ou d’une partie du texte est formellement interdite.
Mercredi
6h am
Poste Marchand
Gérard savait qu’il devait être là, ici, assis dans sa camionnette rouge, avec à son coté Raymond. Raymond est comme tout le monde, un rescapé du tremblement de terre, qui n’a su sauver que son bras gauche. Comme tout le monde ici, Raymond avait laissé quelque chose de lui, là-bas, sous les décombres. On a tous perdu quelque chose, ici, ce mardi-là. Les uns : des bras, des pieds ou autres parties du corps, les autres le sourire, l’imprudence et l’amour de ce pays, cette terre tremblotante comme les enfants souffrant d’épilepsie.
Ici, si tout le monde connaissait Raymond, personne cependant ne savait rien de son histoire qu’il refuse de raconter. Personne ne savait où était Raymond, ce mardi. Les uns pensaient qu’il était au pénitencier national, les autres à l’église Méthodiste de Poste Marchand. Pénitencier ou église, quelle différence? On est toujours sous une dalle, cerné de quatre murs. Et Dieu seul sait combien de dieux habitent les prisons… C’est peut-être par vanité que Raymond n’ajoutait rien à son récit.
Gérard lui, n’était pas comme tout le monde. Il était ce jour-là dans sa camionnette rouge, et il aurait juré que c’était un camion Mack, 10 roues et 8 cylindres, qui avait heurté l’arrière de sa camionnette tellement la terre la secouait. Dieu soit loué, ce n’avait pas été le cas, tout le monde savait combien Gérard aimait sa camionnette rouge, qui nourrissait sa famille qui s’était vue augmenter, après la mort de son frère Castel. A part, perdre quelque chose on en a tous gagné une autre, une nouvelle charge : s’occuper de soi comme d’un autre, se surveiller, inspecter, se préparer à courir à la prochaine catastrophe…
Pour Gérard mieux valait la terre que sa camionnette rouge…
En réalité, la camionnette n’avait jamais été rouge. Mais on l’appelait ainsi car depuis plus de deux ans Gérard avait promis à tout le monde qu’il allait la repeindre en rouge, d’un rouge vif, disait-il. Mais, il y avait toujours quelque chose à faire : remplacer le frein, la batterie, le moteur, l’accélérateur, les pneus, les gentes, les bancs, les coussins, une vitre… et au bout de deux ans la camionnette n’avait toujours pas été repeinte. Mais tout le monde à Poste Marchand, Lalue, Christ-Rois l’appelait, par dérision, la « camionnette rouge » jusqu’à ce que tout le monde finisse par croire que la camionnette était rouge, non de couleur, mais de nom. Et Gérard, lui, avait perdu l’envie de repeindre sa camionnette puisque tout le monde s’était mis d’accord sur ce point là.
C’était une vieille Mazda grise, le gris de l’aluminium nu, deux portes avec une vieille carrosserie en bois d’ébène, par devant laquelle on pouvait lire : « Charité désordonnée commence par soi-même » Ici, toutes les camionnettes ont leurs slogans. Parfois brutal, et parfois doux, comme par exemple, le prénom d’une femme. Une camionnette sans slogan n’attire pas de passagers. A la station, on peut passer des journées entières à les lire, les corriger et en sourire :
« Bon Dieu bon, Bon Dieu rit, Rien ne sert de courir il faut partir a point, kapab pa soufri, Pa gad ale m’, Yes aya, Tèt frèt, L’homme pas Dieu, Adrianna, Tèt kale, Don’t follow me, Vierge miracle, Malè pa mal, Pito nou lèd nou la, Rosemarie Chérie, Christ revient, Psaume 113 v7, Kris kapab, Bon ti grenn, La force divine, I love you Jesus, One love, La destinée, Ave Maria, Don de Dieu, La familia, Echèk pa lanmò, Jesus is my life… »
Ici, à la station on peut lire tout un livre avec des phrases ambulantes qui ne sont jamais les mêmes, dans leurs innombrables va-et-vient…
La Camionnette de Gérard ne se faisait pas remarquer uniquement par son écriteau noir mais aussi par le bruit insupportable que faisait le moteur. On pouvait l’entendre depuis l’église Saint Antoine. Bien qu’insupportable, tout le monde ici supportait le bruit. On avait développé une certaine affinité pour Gérard et sa Camionnette. Peut-être par ce qu’il distribuait, tous les soirs, une partie de ses recettes, aux enfants du quartier…
Wébert Charles, extrait de La Camionnette rouge, Finaliste prix du Jeune Écrivain de langue française en 2013.