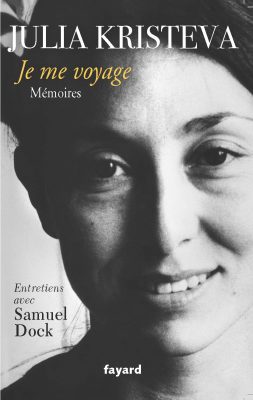Photomed Liban, un rendez-vous avec la Méditerranée dans son âme, changeante
Le Festival Photomed Liban est devenu un rendez-vous annuel attendu des artistes mais aussi des aficionados de la photo. De par la richesse de sa programmation et de par le nombre de photographies présentées, il constitue le plus important festival de photo au Moyen Orient. De par la liberté qu’il cultive aussi en donnant à voir des regards multiples et divers dans un environnement ou les grilles de lecture sont de plus en plus étroites. La lecture que fait Guillaume de Sardes, Directeur Artistique de l’exposition, mérite en elle-même, un arrêt. Les textes du romancier, également photographe, qui accompagnent l’exposition nous plonge d’emblée dans la Mare Nostrum d’aujourd’hui, avec sa part d’inchangé et d’indompté.
Trois thèmes sont à l’honneur dans cette quatrième édition du festival: Beyrouth, le cinéma, et la poésie des ruines. Des thèmes, des rencontres et des échanges à travers lesquels les organisateurs visent à «concourir au rapprochement des peuples à travers un art, la photographie, dont (ils) revendiquent l’universalité» comme le dit Mr Philippe Heullant, Président du Festival. Et à travers lesquels, ils suscitent au-delà de l’émotion, assurément des interrogations et réflexions.
Si parfois elle enjolive, la photographie, dans le présent et l’instantané est dans ce sens, sans pitié, car le présent est ce qu’il est et Beyrouth, objet de prédilection de cette exposition n’est plus celui des cartes postales. Apres sa guerre, la ville est abandonnée à son sort, multiple, dont ce festival rend bien compte. Georges Awdé, basé, au Qatar capture des refugiés, dans la beauté des corps adolescents, trop tôt initiés à la cruauté de ce monde en conflit ; Giulio Rimondi quelque chose de l’attente et tout à la fois d’ineffable à l’heure ou tombe le jour sur la ville; Danielle Arbid et Lara Tabet, les corps et les âmes qui s’y dénudent et jouissent, se frayant leur propre chemin entre les roseaux sauvages de Raouché, les boites de nuit ou les plateaux de tournage.
La Méditerranée, matrice de l’exposition, n’est pas celle de la dolce vita – à l’exception des photos de Riboud – que nous portons dans notre mémoire collective. Et si les clichés de Richard Dumas sur les tournages d’Antonioni, renvoient à la solitude de l’homme en dépit du glamour de Cinecitta et de l’amour, ceux des artistes d’aujourd’hui renvoient plus à une réalité des corps et des vies dans leur pleine humanité avec ce qu’elle a d’ambivalent: celle de jeunes refugiés syriens perdus dans l’attente et l’entre deux ; celle des bimbos siliconées qui se dorent et s’exhibent sur les plages de cette même mer qui broient ses fils, migrants d’un rivage à un autre… lorsqu’ils l’atteignent. La Méditerranée ici n’est plus celle d’Ulysse et du voyage. Même le regard occidental comme celui de Nick Hannes l’a compris. Sa photographie comme celle des autres européens de l’exposition n’est pas orientaliste ; elle donne à voir sans pathos, avec empathie du moins. C’est le cas aussi avec Nicole Herzog Verrey dont l’exposition a inauguré le festival et qui restitue toute leur splendeur aux vieilles pierres lesquelles se trouvent en concurrence avec les échafaudages, le métal et le béton. Là encore un entre-deux, un sentiment d’attente ou de suspension : l’art de vivre méditerranéen semble lui aussi suspendu. Par delà la frénésie humaine, Herzog Verrey en revient à la pierre et aux arbres, solides et impassibles dans leur présence. La pierre, elle aussi s’érode. C’est le sujet de Ferran Frexcia , celui de la fragilité des choses y compris celle de la pierre, récupérée par la nature, qu’il s’agisse de palais ou de bâtiments industriels. Et quand ce n’est pas le temps qui use, c’est le feu qui brule comme le montre la série consacrée au Grand Liceu à Barcelone.
Aux cotés des photographes exposés choisis de part et d’autre de la Méditerranée, d’une génération et d’une autre, cinq galeristes libanais ont aussi ouvert leurs portes au public présentant des artistes qu’ils défendent : Galerie Agial avec Clara Abi Nader, Galerie Alice Mogabgab avec Maria Chakhtoura, Galerie Janine Rubeiz avec Rania Matar et François Sargologo, Galerie Tanit avec Gilbert Hage, et The Alternative avec Michel Zoghzoghi. En parallèle du festival un prix de Lectures de portfolios est remis tous les ans. C’est le célèbre photographe français Richard Dumas qui en présidait le jury cette année. Le premier prix est exposé à Photomed France l’année qui suit ; le deuxième prix à l’Institut Français à Beyrouth. Le soutien continu de l’Office du Tourisme du Liban a Paris et de grandes institutions comme la Banque Byblos, LIA Assurance et Le Gray ainsi que des ambassades Suisse, d’Espagne et d’Italie et de l’Institut Français, promettent des éditions à venir denses et le désir de continuer à promouvoir Beyrouth comme une «ville de tolérance» et de «militantisme » selon les mots de Guillaume de Sardes. « N’importe quelle image a une charge politique en creux » confesse-t-il, quand bien même ce n’est pas le politique n’est pas le propos de l’exposition. Quand les sujets abordés par les différents photographes libanais, qu’il s’agisse de départ ou de retour, traitent de frontières qui s’effacent et de rencontres qui se font… le directeur artistique de l’exposition y a vu «une volonté de parler de liberté ».