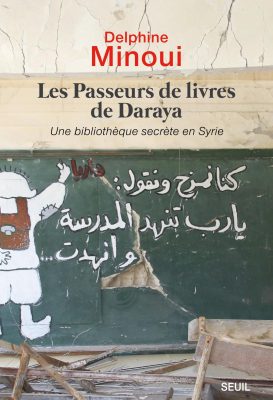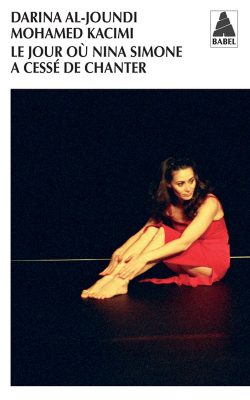Par défaut, ou la nécessaire perte d’innocence
Je ne m’étais pas encore résolue à faire des choix par défaut, plutôt par adhésion… sauf en matière d’élections, je me résous. J’espère que ce ne sera pas le premier de plusieurs «par défaut». Crainte de la perte d’illusions, de la nécessite des compromis, corollaire de l’avancée en âge. On se retire alors par moments dans la littérature, dans la philosophie, ou dans la nature, pour se protéger de la violence du monde, pour ne pas perdre foi ; ne pas perdre toutes ses illusions toutes à la fois. Sauf qu’il s’avère impossible de se voiler la face devant tous ces billboards de x mètres sur x qui envahissent chaque carrefour, chaque autoroute, qui brillent de jour comme de nuit, les banderoles qui couvrent chaque mur libre, chaque poteau électrique ; des enflés, des moustachus, des blindés, des cravatés, des fermés, des reconvertis… Ils prennent nos yeux d’assaut comme les pubs pour produits ménagers en grandes surfaces. Qui dit mieux ? Achète-moi, prends-moi, semblent crier les photos. Les candidats donnent leurs photos en pâture ; mais pas leur programme électoral, leur biographie, etc. Les slogans ne volent pas haut : on veut de la transparence pas de la brume ; on ne veut plus de ferme, etc. Ensuite, il y a les jeux de mot sur les noms de famille et comme les noms libanais s’y prêtent, c’est parti. Tu es notre fusil ; ton vote est englobant… Avocat, militaire, philanthrope, grandes figures occupant ou ayant occupé des fonctions publiques, font l’objet de slogans à deux balles. A-t-on lancé ces slogans avec ou sans leur accord ? On n’en sait rien ; toujours est-il que ces slogans disent assurément l’ère de la médiocrité. On se demande s’il y a des agences de communication derrière, on espère que non. Certains médias se targuent de proposer des programmes montrant les candidats dans leur quotidien voire les interrogeant sur leur vie privée – de manière parfois intrusive et insistante – plutôt que de les interroger sur des débats de société et sur leur programme électoral. Même les médias – pas tous, heureusement – cherchent la facilité. La culture de l’immédiateté, du rapide, du prêt à consommer. On a l’impression d’être dans un tabloïd, une campagne de télé-réalité plutôt que dans une campagne électorale. Est-ce sur ces bases que l’on choisit nos élus?
Il y a aussi les coups de fil reçus à domicile, de représentant de tel candidat et de tel autre, pour beaucoup qui se font rabrouer par des citoyens à bout de nerfs. Même certains nouveaux candidats ont pris les habitudes des anciens, soumission à ce que Max Weber nomme « l’autorité de l’éternel hier ». Nous sommes les champions de l’éternel hier, sauf quand il s’agit de la pierre – là on a tout détruit ; car alors l’éternel hier venait contredire la matière, le billet vert. S’ils ne se cassent pas la tête pour faire leur campagne, y mettre du contenu ; que serait-ce alors lorsqu’ils seront au pouvoir ? Plus rien à conquérir, à prouver.
On entend pourtant encore au XXIème siècle, beaucoup d’électeurs, et parmi eux des jeunes, instruits, dire : je n’ai pas le choix, je suis obligé de voter pour un tel ou pour un autre tel ; il est de la famille, c’est un ami d’enfance ; même si je ne suis pas du tout d’accord avec la ligne qu’il a pris. Ainsi, c’est au choix la soumission à l’éternel hier ou la servitude volontaire, le choix de la facilité. Saurons-nous un jour nous défaire de certaines loyautés ataviques insidieuses? Comme quand c’est criant de puanteur ; comme quand on circule dans Beyrouth actuellement. On a beau vouloir détourner son attention, respirer par la bouche, parfumer nos intérieurs, la pestilence vient nous narguer.
Une amie architecte libanaise de renommée internationale, vivant à l’étranger, de passage au Liban, me livre avoir pensé recycler tous ces billboards, affiches, banderoles, et en faire des sacs – son dada c’est l’écologie, l’économie circulaire – une autre surenchérit des sacs poubelles. Au-delà de l’humour et du sourire que l’image suscite, l’idée est géniale. Cela aiderait au moins à ramasser les déchets. LCI titre un de ses reportages : Le Liban poubelle de la Méditerranée ; il n y a pas de quoi s’enorgueillir. Est-ce tout ce marasme qui entretient le souffle créatif? Vaut-il mieux une vie bien réglée, bien prévisible ou la nôtre qui nous éreinte, qui nous pompe mais qui nous fait aller puiser en nous toutes les ressources possibles pour demeurer vivants, vibrants? Je ne sais pas. Je sais seulement que l’on ne peut complètement faire abstraction de l’environnement ; et que ces élections nous font poser des questions philosophiques, tout comme celles qui ont précédé. Ne rien faire ou faire ce que l’on peut ? Se traduisant aujourd’hui par voter ou ne pas voter? Rester ou partir? Ou pire encore repartir après être revenu? Ceux qui décident de ne pas voter parce qu’ils ne croient pas ou plus à l’impact de leur voix ou à un choix – devant des alternatives qui sont des non choix – sont pour leur part clairs quant au renoncement.
En état de défiance permanent et généralisé, nous ne pouvons avancer, n’ayant plus aucun point d’appui pour cela. Au cours d’un débat passionné et respectueux à l’Université Américaine de Beyrouth autour de la question de la préservation de la mémoire et de la construction, de l’espace public et de l’espace privé, etc, l’architecte Antoine Chaaya – partenaire dans le studio Renzo Piano – en charge du projet du Musée de Beyrouth, donne une leçon de pragmatisme non dénué de poésie. Accepter la mutation des cités, agir dans le cadre des contraintes mais aussi avec une vision directrice. Et même si l’on est bien loin d’être pragmatique et que l’on vit ici, l’on ne peut s’empêcher de vouloir diriger notre regard autrement, d’observer que oui pour la première fois il y a un site web elections.gov.lb voulant informer le citoyen ; que certains mouvements nouveaux ont pris la peine d’imprimer et de distribuer des pamphlets plus ou moins détaillés pour informer sur leurs membres – parmi lesquels se trouvent des têtes pensantes et dynamiques – et leurs idées ; et aussi de sourire à ce panneau d’affichage plus coloré, plus frais que tous les autres qui figure une jeunesse représentative de 800 000 nouveaux électeurs. Et on se reprend à vouloir croire… Autrement, à rêver le départ