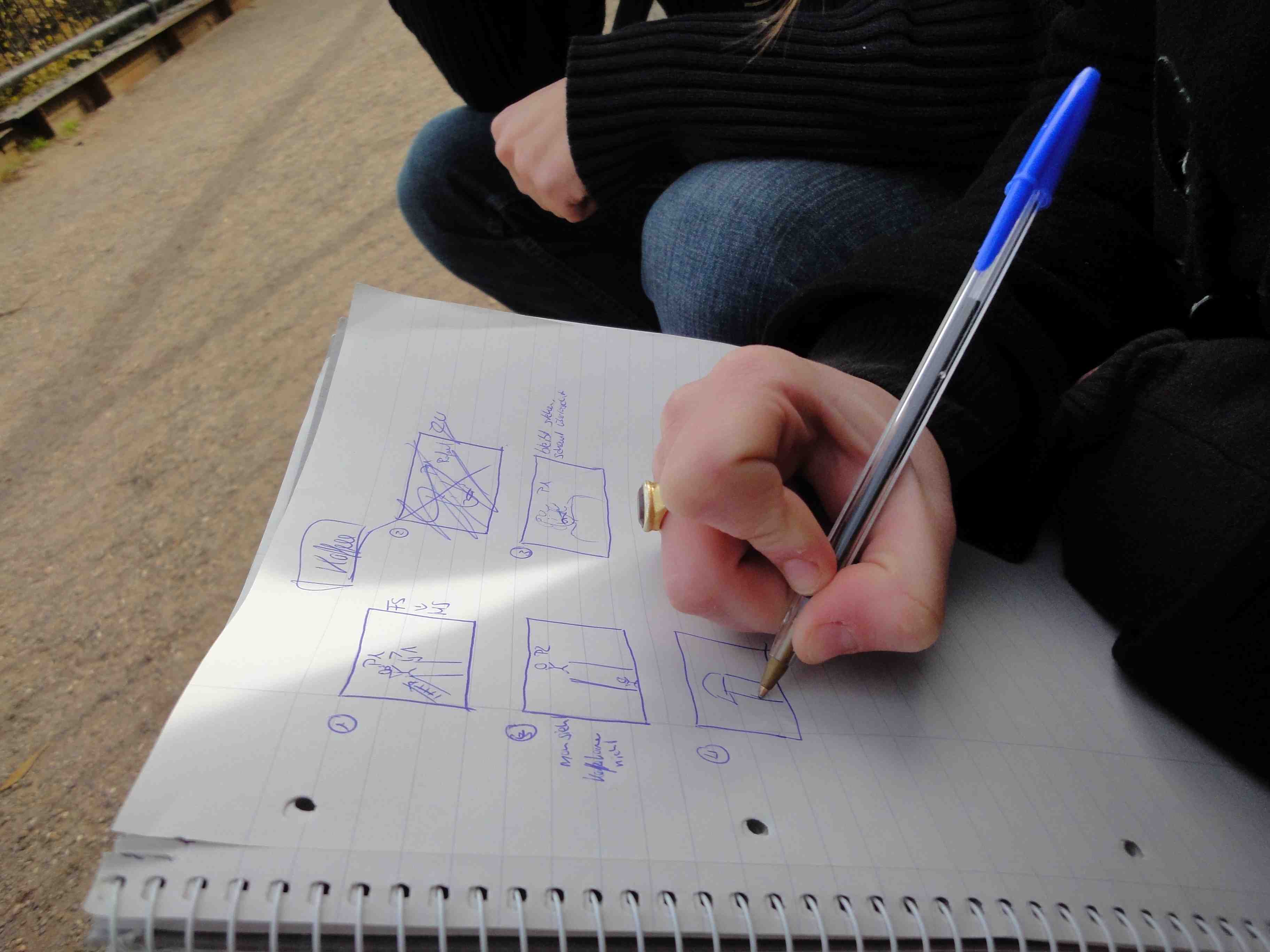Bonhomme rouge, bonhomme vert : une histoire de la discipline allemande
Pas une voiture à l’horizon, la route est libre à perte de vue, mais le petit bonhomme du feu de croisement est rouge. Le citoyen allemand restera planté là, dût-il geler par -5 degrés, à attendre qu’on lui donne le feu vert.









 Dernièrement, j’ai passé une journée à Paris. A peine débarquée de l’avion, l’angoisse des embouteillages m’a saisie; j’avais peu de temps et je savais que cette ville vous le mange goulûment. Puis le métro me sauta à la gorge comme un chien enragé, une bête agitée de milliers de corps survoltés courant dans les couloirs et se battant pour une place assise dans les wagons.
Dernièrement, j’ai passé une journée à Paris. A peine débarquée de l’avion, l’angoisse des embouteillages m’a saisie; j’avais peu de temps et je savais que cette ville vous le mange goulûment. Puis le métro me sauta à la gorge comme un chien enragé, une bête agitée de milliers de corps survoltés courant dans les couloirs et se battant pour une place assise dans les wagons.