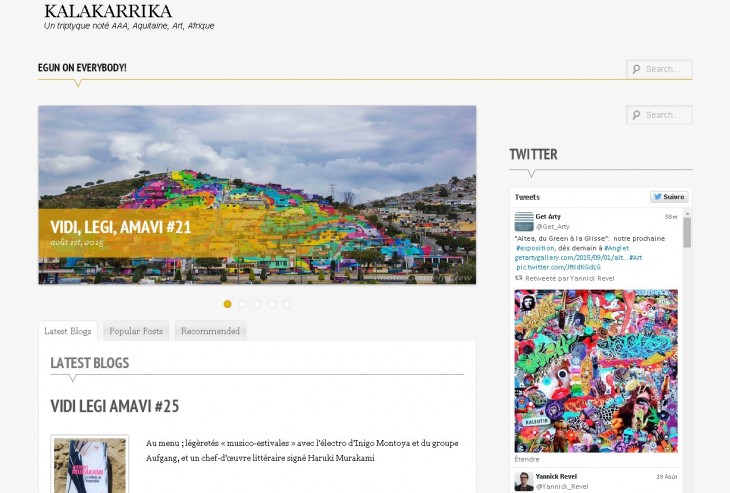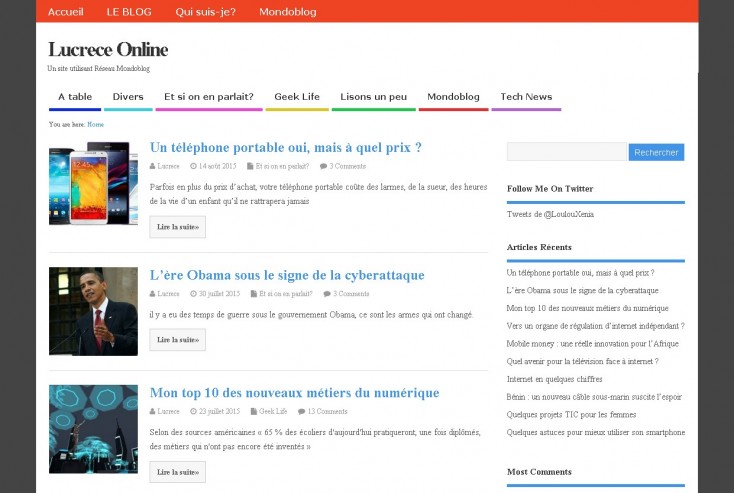Les pépites de Mondoblog : les blogueurs au chevet de l’humanité
Bonjour à tous,
La quinzaine qui se termine est marquée par l’afflux de migrants, qui a fait et continue à faire la une des journaux, des magazines d’information et des sites Internet à travers le monde. Les Mondoblogueurs n’ont pas été insensibles à cette actualité. Nombre d’entre eux ont joint leur plume à la voix d’une grande partie des citoyens du monde pour crier leur indignation face à cette manifestation de la misère humaine, décidant ainsi d’interpeller les consciences afin qu’elles réagissent.
Le monde s’est soudain ému de la catastrophe humanitaire qui se déroule depuis de nombreuses années déjà en mer Méditerranée grâce à une image: celle du petit Aylan Kurdi, trois ans, dont le corps a été retrouvé sans vie et que la mer avait rejeté sur une plage turque. Sur le sol du monde, un enfant est le titre du court poème que cette image a inspiré chez un Mondoblogueur. Cette image, Jean-Robert Chauvin a évité de l’utiliser dans sa revue du monde, en expliquant pourquoi. A la place, il a choisi de montrer des images de refugiés Syriens en Jordanie, bien vivants. Djarma Attidjani a établi les responsabilités de cette tragédie et pour lui, tout le monde ou presque est fautif: les pays arabes qui passent leur temps à critiquer l’Occident mais qui ne font rien pour sauver leurs propres populations qui prennent la mer par bateaux entiers; les pays européens qui disent ne pas vouloir « accueillir toute la misère du monde » mais dont la participation aux conflits qui ont généré ces crises migratoires n’est un secret pour personne.
S’inspirant sûrement de cette actualité, David Kamdem a vêtu le temps d’un poème les oripeaux d’un immigré clandestin en quête d’humanité.
Cette image a finalement décidé quelques pays européens à ouvrir leurs frontières qu’elles tenaient résolument fermées aux migrants. Jeff Ikapi a eu l’idée d’illustrer l’une des conséquences de cette ouverture des frontières en montrant un passeur content des affaires qu’il ferait grâce à cette décision. De son côté, Serge Katembera souligne une certaine hypocrisie des Brésiliens qui s’émeuvent devant ces images d’embarcations bondées en Méditerranée alors que leur propre pays a ses problèmes migratoires qu’il n’arrive pas à régler.
Les réfugiés n’ont pas été le seul cheval de bataille des blogueurs. Ils se sont beaucoup inquiétés pour l’environnement. Dans un article fleuve, Dieretou a montré l’envers du décor (dont les principales victimes sont les populations riveraines) de l’exploitation de la bauxite à Kamsar, en Guinée-Conakry. Naly, à travers des images chocs, montre les dégâts de la pollution – engendrée en grande partie par le capitalisme – et se sert d’un proverbe indien pour avertir du péril qui menace la planète : « quand l’homme aura coupé le dernier arbre, pollué la dernière rivière, tué le dernier animal et pêché le dernier poisson, il s’apercevra que l’argent n’est pas comestible ». L’Ivoirien Magloire Zoro s’inquiète de l’annonce faite par l’Organisation des Nations Unies déplorant le manque de financements pour l’organisation de la COP21, la conférence internationale sur les changements climatiques qui doit avoir lieu en cette fin d’année.
Il a aussi été question d’éloignement, avec Mariam Sorelle qui évoque un départ rempli de larmes; de nostalgie à l’exemple de Pierre qui se rappelle avec un certain amusement des situations que la cherté de la vie en Suisse peut provoquer, ou d’Emmanuelle Gunaratne qui se remémore les différentes nuances de saveurs qu’a pris le café au fil des ans; de désillusion amoureuse, comme celle par laquelle est passé Steaves, qui ne veut plus entendre parler d’amour.
Malgré ce marasme, le soleil a quand même réussi à faire passer deux de ses rayons à travers la grisaille. Le premier est cette séquence de drague un peu alambiquée mêlant à la fois la musique, l’inconfort d’un long voyage et le blog, racontée par le blogueur Togolais Guillaume Djondo. Le deuxième rayon de soleil est le blog faisant l’objet du focus cette semaine…
Focus sur…
La personnalité de l’auteur de ce blog, quand on le découvre, est très troublante. On se retrouve dans une certaine confusion. Le Berlinographe… Jule… Mais qui s’exprime au féminin. Une confusion de genres. Des textes si réels, qui décrivent des épisodes de vie totalement plausibles. Mais au détour d’une phrase, on ne sait plus. L’irréel. Une confusion de réalités. Tout au long de ses articles, l’auteure (après certes de longues tergiversations, on finit par deviner les traits féminins de la personne derrière les textes) nous entraîne dans un quotidien absolument romanesque et profondément romantique, fait de Berlin et d’ailleurs ; fait de doutes, de joies. Un quotidien jadis sombre, devenu clair-obscur. Ces lettres qui défilent dans sa vie. Des lettres, ces initiales qui chacune ont suscité de la félicité et provoqué du chagrin. Ces initiales qui l’ont mise quelques fois dans un avion, pour des destinations pleines de promesses, mais souvent décevantes. Ces lettres qu’elle aime d’un amour infini, qu’elle peut aligner indéfiniment, à force de tapotements sur un clavier, sur des pages et des pages. Jule, à travers des paragraphes longs et interminables, nous balade à travers son insaisissable réalité, largement saupoudrée de sensualité et d’une extrême sensibilité. Je vous invite découvrir ou à redécouvrir ce blog rempli d’humanité et dans lequel tout est vrai, mais où il faut se garder de tout prendre au pied de la lettre.