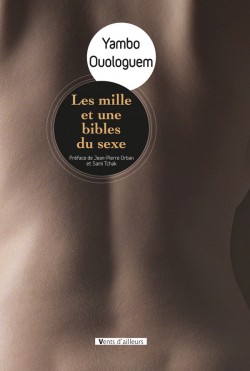Mali, tout le monde veut partir
Jeudi 10 septembre. C’est l’heure, il faut partir. Partir, malgré une sœur qui a du mal à contenir ses larmes à l’idée qu’elle va, pour la première fois, passer plusieurs mois sans me voir. Malgré ses regards, tristes et angoissés, d’enfants qui me fixent pendant un moment comme pour me designer coupable. Coupable de les abandonner. Coupable de partir. J’en viens à me demander si je ne fuyais pas plutôt, parce que lassé de ce pays qui commence à sentir la gangrène, qui a l’air d’un grand corps malade. Mais mon optimisme n’est pourtant pas entamé. Je reste convaincu que ce pays changera, que beaucoup de choses ont changé ailleurs, dans d’autres pays, et qu’il n’y a aucune raison, mais vraiment aucune, qu’elles ne changent pas ici. Tout de même, je pars.
Je ne pars pas pour partir, autant le dire tout de suite, mais pour me changer les idées, explorer d’autres horizons, affronter d’autres réalités. Ici, rester, se battre pour ce qu’on aime, veut, c’est vouloir survivre. C’est vouloir vivre au jour le jour. Ici, on ne vit pas, on survit. Ici, pour reprendre John Jerry Rawlings, on travaille « affamé en se demandant quand et d’où viendra le prochain repas. »
Le sommeil est difficile, parce que les soucis sont lourds à porter. Le drame, c’est qu’il n’y a personne à qui se confier. Partout, ou presque, c’est toujours la même rengaine : ça ne va pas. Ou, autrement dit, ça ne va que pour cette « infime minorité de gloutons. » Partout, c’est la débrouille. La mal vie. La mal bouffe. La misère. Et, au final, la maladie qui vous ronge. Et la mort finit par vous « manger ». C’est comme si on vivait pour rien, comme si on ne signifiait rien, comme si on n’était rien. Rien, pas même des notes de bas de page.
Dans le vol AF 3873 qui nous amène à Paris, je réfléchissais comme jamais je n’avais réfléchis. Pour la première fois, je partais loin, très loin, des miens. J’ai peur pour moi et pour eux aussi. Il y a aussi la peur de l’inconnu. Mais je me console en disant que je finirais par m’habituer, m’intégrer. Dans l’avion, me viennent en mémoire les réactions des amis, parents, collègues…reçues quand je leur ai annoncé mon départ.
« Hormis les vacances, il ne faut plus revenir dans ce pays cruel et infernal. », m’écrit un camarade étudiant, ignorant que je pars pour quelques temps seulement. J’ai été désolé en lisant son message et une vérité, quoi qu’oppressante, est apparue : ici, tout le monde, les jeunes surtout, veut partir. Ils voient dans le départ l’espoir d’une vie meilleure, réussie et pleine de bonheur. Ils voient dans le départ une sorte de délivrance, comme celle que ressent une femme en couches. Partir.
Pour eux, rester, c’est choisir d’être quelqu’un qui ne serait jamais rien. Ils te conseillent de faire tout pour ne pas revenir. « Tu vois toi-même le pays, disent-ils. Tu sais déjà ce qui se passe. Le mort ne sait pas ce qui l’attend dans la tombe, mais il sait ce qu’il a quitté. » Tout le monde veut fuir, comme si en restant, on était voué à l’échec, à l’oubli, à la misère.
J’essaye de trouver une explication. Me vient alors à l’esprit le souvenir d’un débat auquel j’ai participé à la radio Studio Tamani à Bamako. Parmi les sujets que nous devions commenter-nous étions trois journalistes-, il y avait le drame de l’immigration. Le journaliste m’a posé la question :
« Est-ce que le pays fait assez pour retenir les jeunes ? »
Je ne dirai pas que c’est une question à la con, mais je crois que la réponse ne se cherche pas. J’ai répondu que, dans un pays où les élites de la haute administration ne pensent qu’à s’enrichir illicitement, il faut s’attendre à ce que les jeunes partent. Pourquoi vont-ils rester ? Pas d’emploi pour eux, horizon bouché, rêve de vie meilleure brisé.
Boubacar Sangaré