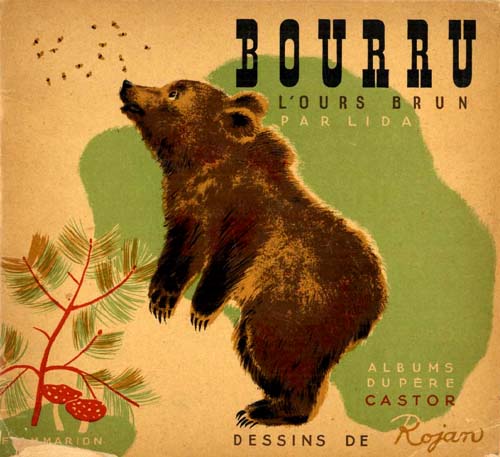Berlin, Eurohorreur 2012
Depuis la dernière Coupe du Monde de foot, je n’avais pas vu Berlin dans un tel état. Adieu, douce cité extravagante, avant-gardiste, libre et anarchiste! « Wilkommen » l’horreur des écrans plats et des enceintes qui crachotent des beuglements de joie à chaque but. Berlin, capitale de la hype? Pas en ce moment. A moins que le ballon noir et blanc ne soit un accessoire tendance 2012?
Voilà une semaine environ que je souffre corps et âme.
En terrasse de ma pizzeria préférée, où servent des punks assagis : un écran blanc et un projo qui balance la coupe d’Europe 2012.
Dans ce bar sympathique de Neukölln, où nous écoutions autrefois (dans un temps qui me semble déjà lointain, comme si j’avais soudain soixante-cinq ans) du jazz en hochant nos têtes pleines de considérations snobs sur la dernière pièce (nulle) jouée à la Volksbühne : un écran géant qui hurle à chaque fois que la balle bondit.
Impossible d’y échapper : la coupe d’Europe a littéralement envahi Berlin avec ses couleurs hideuses, insultantes pour tout esthète qui se respecte (noire-rouge-jaune, la combinaison artistiquement perdante). Au café du coin, la respectable serveuse de soixante ans porte une casquette ornée de deux mini-drapeaux aux couleurs de l’Allemagne. Les voitures pavoisent également, faisant ressembler les parkings à l’arène des jeux Olympiques de 1936.
Le balcon de mon voisin est à un manifeste nationaliste à lui seul. Même ses nains de jardin sont enveloppés d’un drapeau teuton. Un matin, nous vîmes ce flic retraité et désoeuvré s’adresser à la propriétaire du balcon qui jouxte le sien. Armé d’un mégaphone, en marcel noir et les joues couvertes de maquillage pro-équipe d’Allemagne, il l’apostropha :
Madame Benz, pourquoi n’avez-vous pas de décorations pour l’Euro 2012 sur votre balcon?
Madame Benz se sentit minable d’avoir été montrée du doigt en pleine place publique. Elle couvrit dès le lendemain sa petite terrasse de loupiottes et de drapeaux de plastique. Bienveillant, le voisin lui offrit même une guirlande de fanions allemands. Depuis, la banderole s’étend sur les deux balcons, émouvante déclaration d’amour sportif.
Que Madame Benz et mon voisin flicard aient des poussées nationalistes, passe encore. Mais que mes propres amis, qui sont ma chair et mon sang pour l’exilée sans famille que je suis sur ces terres allemandes, se passionnent pour les pérégrinations d’une balle de cuir poussée par une bande de types mal coiffés, non!
Les garçons accros au foot, j’ai toujours connu ça. Souvenirs mémorablement ennuyeux de mon premier amour, vulgairement avachi en cercle avec sa bande devant un carton Pizza Hut exhalant des relents de graisse hydrogénée, sursautant régulièrement quand la balle frôlait la cage…
Souvenir pénible de l’homme de ma vie (mon père) trouvant soudain le foot sympathique, lui qui n’avait jamais aimé que les échanges de balles gracieux de Roland-Garros, juste parce que mon frère se ramenait avec des bières à siroter entre « père et fils »…
Mais tout cela prend à Berlin des proportions monstrueuses : ici, les filles se mettent à croire que le foot, c’est hype. C’est du dernier chic de pousser des cris rauques à intervalle régulier, de boire d’infâmes breuvages à bulles et de se tenir par les épaules, bien carrées, comme des rugbymen.
Ma copine italienne qui disait détester le foot s’est prise d’amitié amoureuse pour un joueur à tête de grenouille dénommé Özil. Ma copine grecque, une passionaria hyper politisée, est scotchée devant un terrain vert avec un rond blanc au milieu, même quand son pays est en train de virer ultra-nationaliste aux législatives. Et même ma copine bosniaque qui est une cérébrale forcenée peste parce que son pays n’a pas d’équipe et qu’elle est obligée de faire semblant d’être pour les Croates.
Alors ce soir, devant une Eurohorreur de plus, tandis que j’étais en train de faire la conversation seule à une brochettes d’amis aux yeux épinglés à un écran situé dans mon dos, j’ai pris mes cliques et mes claques. Je me demande même s’ils s’en sont aperçus.
Je me suis dit que j’allais cracher mon désespoir sur mon blog, même si à l’heure qu’il est, vous aussi, chers lecteurs, vous frémissez en attendant le match France-Angleterre de ce soir et que vous avez déjà deserté cette page anti-ballon.
Je vous pardonne ! Sur mon vélo, en rentrant à une heure pour une fois raisonnable, je me suis aperçue que Berlin m’appartenait : 90% de la ville était devant un écran et moi, seule sur mon fidèle destrier, je pédalais comme un cygne glisse sur l’onde, majestueusement ignorée et finalement… tranquille…
…un peu trop tranquille?