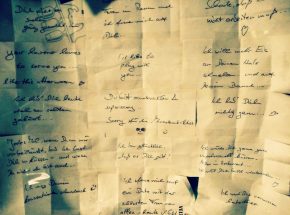Pourquoi elle est la plus triste
Je croyais avoir évité la passion. Pour une fois. Une fois. L’unique, la bonne. Un Autre, présent, là, dans ma ville. Un Autre simple, ni trop ancré, ni trop loin dans ses propres pensées. Là, dans ma ville. A quelques rues de chez moi. Qui n’a prévu d’aller nulle part. Moi non plus.
Pas de voyages au-delà des frontières, pas de ces voyages où l’on s’épuise à s’oublier, où l’on s’épuise à se retrouver, des week-ends entiers dans des draps, nus, baignés de soleil, des soirées dans l’eau de bains brûlants, des larmes chaudes sur les quais de gares bien trop froides, dans la blancheur malsaine des aéroports. Pas cette fois non, pas cette fois.
On avait prévu d’aller au cinéma. On avait prévu de se rendre heureux, se serrer l’un contre l’autre sur le canapé quand soufflerait l’hiver berlinois.
On avait prévu de s’aimer à long terme. De se parler. De ne pas pleurer. On aspirait à une certaine normalité.
Et je souris dans le métro qui me ramène à la maison. Ni chez toi, ni chez nous. Chez moi. Où tu ne m’attends pas. Tu es resté dans ma ville, mais pas dans ma vie, même à quelques rues de moi.
Parce que nos rêves d’adultes n’ont pas tenu deux minutes. L’illusion n’est plus.
On n’est jamais allé au cinéma. On n’a pas eu le temps de se serrer l’un contre l’autre sur le canapé du salon. Tu n’as pas su parler, et moi ne pas pleurer.
Je souris, un peu amère, jaune il est clair, car ce qui ne devait pas arriver prend forme sous mes yeux humides. Ce qui ne devait pas l’être rayonne de toute sa stupide splendeur. Te voilà officiellement la plus triste de mes passions amoureuses. Même pas la plus intense, même pas la plus belle. La plus courte. Maladive.
Parce qu’après les silences, les pleurs et les cris, le constat me fait sourire, jaune : tu m’aimes, je t’aime, mais nos deux âmes adolescentes ne savent pas s’aimer. Trop jeunes pour s’oublier. Trop adultes pour essayer. L’impossible.
Plus passionnel on ne fait pas. Plus stupide non plus. Plus stupide non plus. Parce que dans cette impasse tu me tiens la main. J’enfouis mon visage dans ton cou. Tu embrasses mes cheveux. Et nos cœurs battent en déséquilibre.